
La Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») vient de gâcher un peu la fête en durcissant – encore - l’approche sévère qu’elle réserve aux compagnies aériennes en matière d’indemnisation de retards de vol. - Photo DR
Après un bénéfice net record de près de 20 milliards de dollars attendu pour 2014, l'ensemble des compagnies aériennes pourrait profiter de la baisse du pétrole pour faire encore mieux en 2015, avec 25 milliards de dollars, selon les prévisions de l'Association du transport aérien international (Iata).
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») vient de gâcher un peu la fête en durcissant – encore - l’approche sévère qu’elle réserve aux compagnies aériennes en matière d’indemnisation de retards de vol (Ordonnance de la CJUE du 14 novembre 2014, affaire C-394/14).
Comme nous avons déjà pu le rappeler dans un précédent article, les passagers de vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport de l’Union européenne peuvent se prévaloir d’une indemnisation automatique et forfaitaire, pour toute annulation ou tout retard de vol de plus de 3 heures.
En effet, une jurisprudence constante – tant au plan européen qu’au plan national - assimile tout retard de transport aérien de passagers de 3 heures ou plus à une annulation de vol (CJCE, 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07 ; pour la première application en France de cette solution : jugement du tribunal de proximité de Paris 10e en date du 7 février 2011, RG n°91-10-000187 et 91-10-000193).
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») vient de gâcher un peu la fête en durcissant – encore - l’approche sévère qu’elle réserve aux compagnies aériennes en matière d’indemnisation de retards de vol (Ordonnance de la CJUE du 14 novembre 2014, affaire C-394/14).
Comme nous avons déjà pu le rappeler dans un précédent article, les passagers de vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport de l’Union européenne peuvent se prévaloir d’une indemnisation automatique et forfaitaire, pour toute annulation ou tout retard de vol de plus de 3 heures.
En effet, une jurisprudence constante – tant au plan européen qu’au plan national - assimile tout retard de transport aérien de passagers de 3 heures ou plus à une annulation de vol (CJCE, 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07 ; pour la première application en France de cette solution : jugement du tribunal de proximité de Paris 10e en date du 7 février 2011, RG n°91-10-000187 et 91-10-000193).
Quid des circonstances extraordinaires ?
Chaque passager a donc automatiquement droit à une indemnisation forfaitaire de la part de la compagnie aérienne et de l'agence de voyage d’un montant de :
- 600 euros pour les vols de plus de 3.500 km ;
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 km et pour les autres vols de 1.500 à 3.500 km ; et
- 250 euros pour les vols jusqu'à 1.500 km…
sauf si la compagnie est en mesure d’établir que le retard a été causé par un cas de force majeure, ou plus exactement des « circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
C’est précisément sur cette notion que la CJUE s’est prononcée à l’occasion de la décision que nous allons commenter.
En l’espèce, un passager est muni d’un billet d’avion pour se rendre d’Antalia à Francfort. Le vol est opéré avec un retard à l’arrivée de 6h30 (sur la notion de retard à l’arrivée, voir cet article).
- 600 euros pour les vols de plus de 3.500 km ;
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 km et pour les autres vols de 1.500 à 3.500 km ; et
- 250 euros pour les vols jusqu'à 1.500 km…
sauf si la compagnie est en mesure d’établir que le retard a été causé par un cas de force majeure, ou plus exactement des « circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
C’est précisément sur cette notion que la CJUE s’est prononcée à l’occasion de la décision que nous allons commenter.
En l’espèce, un passager est muni d’un billet d’avion pour se rendre d’Antalia à Francfort. Le vol est opéré avec un retard à l’arrivée de 6h30 (sur la notion de retard à l’arrivée, voir cet article).

Martin Lacour - DR
Pour refuser d’octroyer l’indemnisation forfaitaire à ce passager, la compagnie aérienne soutient que ce retard est imputable aux dommages subis par l’avion devant effectuer le vol en cause, la veille à l’aéroport de Stuttgart.
Cet avion y a été heurté par un escalier mobile d’embarquement occasionnant des dommages structurels à une aile et nécessitant son remplacement. Pour la compagnie aérienne, il s’agit de « circonstances extraordinaires » l’exonérant de son obligation d’indemnisation.
La question posée à la CJUE était donc, en substance, de savoir si les « circonstances extraordinaires » doivent se rapporter directement au vol litigieux, ou, au contraire, si elles peuvent découler de trajets préalables effectués par l’avion.
Dans sa décision, la CJUE rappelle d’abord que la prise en compte des circonstances extraordinaires est une dérogation au principe de l’indemnisation des passagers, et qu’elle doit par conséquent être interprétée strictement.
Elle précise ensuite que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas exonératoires et qu’il incombe au transporteur aérien qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation.
Cet avion y a été heurté par un escalier mobile d’embarquement occasionnant des dommages structurels à une aile et nécessitant son remplacement. Pour la compagnie aérienne, il s’agit de « circonstances extraordinaires » l’exonérant de son obligation d’indemnisation.
La question posée à la CJUE était donc, en substance, de savoir si les « circonstances extraordinaires » doivent se rapporter directement au vol litigieux, ou, au contraire, si elles peuvent découler de trajets préalables effectués par l’avion.
Dans sa décision, la CJUE rappelle d’abord que la prise en compte des circonstances extraordinaires est une dérogation au principe de l’indemnisation des passagers, et qu’elle doit par conséquent être interprétée strictement.
Elle précise ensuite que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas exonératoires et qu’il incombe au transporteur aérien qui entend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation.
Définition de la Cour
La Cour donne même une définition des « mesures adaptées à la situation » : ce sont « celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné ».
Enfin, la CJUE, faisant application à l’espèce des règles qu’elle vient de rappeler avec force, dit que « si [des] problèmes techniques [affectant un avion] peuvent être comptés au nombre de telles circonstances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’extraordinaires […] que si elles se rapportent à un événement qui […] n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci, du fait de sa nature ou de son origine ».
S’agissant, dans notre exemple, d’un problème technique trouvant son origine dans le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion, la CJUE estime que de tels escaliers mobiles sont nécessairement utilisés dans le contexte d’un transport aérien de passagers, de sorte que le choc d’un avion avec cet escalier doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
Elle précise qu’il en irait autrement, si (et seulement si !) le dommage ayant causé le retard trouvait sa cause dans un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, « tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme ».
Enfin, la CJUE, faisant application à l’espèce des règles qu’elle vient de rappeler avec force, dit que « si [des] problèmes techniques [affectant un avion] peuvent être comptés au nombre de telles circonstances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’extraordinaires […] que si elles se rapportent à un événement qui […] n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci, du fait de sa nature ou de son origine ».
S’agissant, dans notre exemple, d’un problème technique trouvant son origine dans le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion, la CJUE estime que de tels escaliers mobiles sont nécessairement utilisés dans le contexte d’un transport aérien de passagers, de sorte que le choc d’un avion avec cet escalier doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
Elle précise qu’il en irait autrement, si (et seulement si !) le dommage ayant causé le retard trouvait sa cause dans un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, « tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme ».
Procédure de l'action de groupe simplifiée
Il apparaît donc que le champ des « circonstances extraordinaires » pouvant être invoquées par la compagnie aérienne pour échapper à son obligation d’indemnisation forfaitaire est très restreint !
Surtout, cette décision ouvre la voix aux réparations de retards en cascade.
Or, les compagnies aériennes fonctionnant (trop) souvent en flux tendu, il n’est pas rare qu’un premier retard en entraîne plusieurs autres, et qu’il faille ainsi parfois plusieurs jours pour finir par résorber le délai causé.
Cela devrait d’autant plus alerter les compagnies aériennes et les inciter à modifier leurs pratiques qu’avec l’adoption de l’action de groupe, il est loisible aux associations agrées françaises de protection des consommateurs d’introduire une action en réparation des préjudices causés lors de ces retards en cascade.
La procédure est alors celle – efficace et rapide - de l’action de groupe simplifiée, puisque le nombre et l’identité des passagers est d’ores et déjà connu.
Compagnies aériennes, ne ratez pas le train de la CJUE !
Martin Lacour
mlacour.avocat@gmail.com
Surtout, cette décision ouvre la voix aux réparations de retards en cascade.
Or, les compagnies aériennes fonctionnant (trop) souvent en flux tendu, il n’est pas rare qu’un premier retard en entraîne plusieurs autres, et qu’il faille ainsi parfois plusieurs jours pour finir par résorber le délai causé.
Cela devrait d’autant plus alerter les compagnies aériennes et les inciter à modifier leurs pratiques qu’avec l’adoption de l’action de groupe, il est loisible aux associations agrées françaises de protection des consommateurs d’introduire une action en réparation des préjudices causés lors de ces retards en cascade.
La procédure est alors celle – efficace et rapide - de l’action de groupe simplifiée, puisque le nombre et l’identité des passagers est d’ores et déjà connu.
Compagnies aériennes, ne ratez pas le train de la CJUE !
Martin Lacour
mlacour.avocat@gmail.com













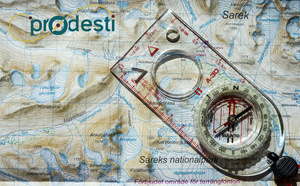










![De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93247694-65219608.jpg?v=1765984636)















