Quimper, Kemper… confluent, en breton. Le nom ne pouvait être mieux approprié. La ville est en effet bâtie à la rencontre de trois rivières. Deux, le Steir et le Frout, se jettent dans la troisième, l’Odet. Cette dernière file ensuite jusqu’à Bénodet et l’océan, à travers une vallée boisée.
Ville d’eau, Quimper l’est donc assurément. C’est d’ailleurs la cause de sa fondation. Nous sommes à Locmaria, quartier villageois situé à 10 mn à pied du centre-ville. Là, rive gauche du fleuve, s’installent au 1er s. après J.-C. les premiers potiers, près de la ressource en eau. Ils succèdent aux Romains qui y avaient fondé un port, Aquilonia.
De la poterie à la faïence, quelques siècles s’écoulent. Sous l’impulsion d’un artisan venu de Provence à la fin du 17ème s., le quartier bascule vers cette activité.
Ville d’eau, Quimper l’est donc assurément. C’est d’ailleurs la cause de sa fondation. Nous sommes à Locmaria, quartier villageois situé à 10 mn à pied du centre-ville. Là, rive gauche du fleuve, s’installent au 1er s. après J.-C. les premiers potiers, près de la ressource en eau. Ils succèdent aux Romains qui y avaient fondé un port, Aquilonia.
De la poterie à la faïence, quelques siècles s’écoulent. Sous l’impulsion d’un artisan venu de Provence à la fin du 17ème s., le quartier bascule vers cette activité.
Atelier Henriot
Trois cent ans plus tard, il en reste un atelier, célèbre dans toute la Bretagne et au-delà : Henriot. Avec le musée de la faïence installé à côté dans une ancienne fabrique, il témoigne du rôle majeur de cet artisanat à Quimper.
La lecture attentive du paysage, elle, rappelle le rôle clef joué ici par le fleuve.
Rive droite, on aperçoit le quartier du Cap Horn. C’est là que vivaient les ouvriers des faïenceries. Chaque matin et soir, des passeurs leur faisaient traverser la rivière. Aux pics de l’activité, dans les années 1850-1880, plus de 500 personnes travaillaient dans les trois grandes faïenceries de Locmaria.
La lecture attentive du paysage, elle, rappelle le rôle clef joué ici par le fleuve.
Rive droite, on aperçoit le quartier du Cap Horn. C’est là que vivaient les ouvriers des faïenceries. Chaque matin et soir, des passeurs leur faisaient traverser la rivière. Aux pics de l’activité, dans les années 1850-1880, plus de 500 personnes travaillaient dans les trois grandes faïenceries de Locmaria.
Locmaria, cluster artistique en devenir
Aujourd’hui, le quartier a retrouvé un nouveau souffle. Au bord de l’Odet, la place du Styvel a été réaménagée. Elle met en valeur la belle façade de l’ex-atelier de céramique d’art P. Foullien.
Derrière l’ancien prieuré, un hôtel de luxe, Gingko, a ouvert. Une micro-brasserie s’est installée sous l’espace Pascal Jaouen, haut-couturier quimpérois. Locmaria devient un cluster artistique. S’y sont installées une plasticienne, une modiste, une céramiste, une architecte en vogue…
Face au jardin médiéval classé « Jardin remarquable », l’église romane Notre-Dame de Locmaria a bénéficié d’une restauration.
Derrière l’ancien prieuré, un hôtel de luxe, Gingko, a ouvert. Une micro-brasserie s’est installée sous l’espace Pascal Jaouen, haut-couturier quimpérois. Locmaria devient un cluster artistique. S’y sont installées une plasticienne, une modiste, une céramiste, une architecte en vogue…
Face au jardin médiéval classé « Jardin remarquable », l’église romane Notre-Dame de Locmaria a bénéficié d’une restauration.
Quimper, cité de la mer
En remontant le bord du fleuve vers l’allée de Locmaria et le centre-ville, nous croisons le QG de l’association « Le Lougre de l’Odet ». Le nom évoque la réplique d’un chasse-marée, un trois mâts caboteur de 1840. « Le Corentin », c’est son nom, sillonne depuis 1991 les côtes bretonnes. Il est visible à quai l’hiver. L’occasion de rappeler que Quimper est aussi une cité de la mer.
Les hautes marées la relient à l’océan et le fleuve a longtemps accueilli goélettes, sloops et vapeurs sur ses quais. Vieilles photos et cartes postales en témoignent. Charbon, sel et vins à l’aller, produits agricoles, toiles de Locronan et faïences au retour : l’activité battait son plein aux 18ème et 19ème s. Jusqu’à la fin des années 1960, Quimper était le premier port breton d’importation des vins d’Algérie.
L’envasement aura raison du trafic maritime, déporté depuis en aval. Mais au sud du pont Max Jacob, quelques maisons nobles d’armateurs et de négociants, quai de l’Odet, rappellent que ces derniers vivaient au plus près de leurs affaires florissantes.
Les hautes marées la relient à l’océan et le fleuve a longtemps accueilli goélettes, sloops et vapeurs sur ses quais. Vieilles photos et cartes postales en témoignent. Charbon, sel et vins à l’aller, produits agricoles, toiles de Locronan et faïences au retour : l’activité battait son plein aux 18ème et 19ème s. Jusqu’à la fin des années 1960, Quimper était le premier port breton d’importation des vins d’Algérie.
L’envasement aura raison du trafic maritime, déporté depuis en aval. Mais au sud du pont Max Jacob, quelques maisons nobles d’armateurs et de négociants, quai de l’Odet, rappellent que ces derniers vivaient au plus près de leurs affaires florissantes.
Le Steïr, affluent de l’Odet
Le pont se trouve quasiment à la confluence du Steïr et de l’Odet. Autre frontière ! Car autour de l’an 1000, le centre de gravité de Quimper se déplace de Locmaria vers les rives de cet affluent. La construction sur les fondations d’une église romane de la cathédrale Saint-Corentin, au 13ème s., conforte la vocation religieuse de la rive gauche du Steïr.
Au pied des deux hautes flèches de l’édifice, totem de Quimper, se déploie un quartier médiéval de chanoines. Il en reste un nombre impressionnant de maisons à pans de bois et l’ex Palais des Evêques. La rive droite du Steïr, en revanche, est celle de l’autorité ducale.
Des anciens attributs de pouvoir, prison, auditoire de justice, fours banaux… il ne reste hélas rien. Mais les rues Saint-Mathieu (depuis le Steïr) ou du Palais (depuis l’Odet) convergent vers un pôle qui souligne, avec le théâtre de Cornouaille et la médiathèque, un autre marqueur fort de l’identité de Quimper : la culture.
Au pied des deux hautes flèches de l’édifice, totem de Quimper, se déploie un quartier médiéval de chanoines. Il en reste un nombre impressionnant de maisons à pans de bois et l’ex Palais des Evêques. La rive droite du Steïr, en revanche, est celle de l’autorité ducale.
Des anciens attributs de pouvoir, prison, auditoire de justice, fours banaux… il ne reste hélas rien. Mais les rues Saint-Mathieu (depuis le Steïr) ou du Palais (depuis l’Odet) convergent vers un pôle qui souligne, avec le théâtre de Cornouaille et la médiathèque, un autre marqueur fort de l’identité de Quimper : la culture.
Reine de Cornouaille
Où l’on retrouve à ce propos les rives de l’Odet ! C’est en effet sur le balcon du Palais des Evêques, face au fleuve, chaque année en juillet, que se présente la Reine de Cornouaille.
Elue lors du festival éponyme, des centaines de personnes se pressent sur les rives pour l’applaudir. A la fin du festival, les berges accueillent aussi son moment phare : le Triomphe des Sonneurs. Nul doute que les mulets de l’Odet perçoivent dans l’eau trouble les échos de cet immense défilé de musiciens bretons…
Elue lors du festival éponyme, des centaines de personnes se pressent sur les rives pour l’applaudir. A la fin du festival, les berges accueillent aussi son moment phare : le Triomphe des Sonneurs. Nul doute que les mulets de l’Odet perçoivent dans l’eau trouble les échos de cet immense défilé de musiciens bretons…
Le Frout, second affluent de l’Odet
Au-delà du Palais des Evêques et de la Préfecture, les berges de l’Odet attestent d’évolutions plus récentes. En 1863, le chemin de fer arrive à Quimper. S’ensuit le corsetage des quais pour faciliter l’accès à la gare. La rivière rétrécit. Elle perd alors ses ilots et même une sorte d’étang.
Les restes de la tour Penn al Lenn (« Tête de l’Etang », en breton ), vestige des fortifications du quartier épiscopal, à l’angle de la rue de Juniville et du boulevard-quai Kerguelen, en sont la preuve. Entièrement canalisé et souterrain, c’est d’ailleurs à cet endroit que se jette le second affluent de l’Odet, le Frout.
A lire aussi : Bretagne : le charme discret de Quimper
Les restes de la tour Penn al Lenn (« Tête de l’Etang », en breton ), vestige des fortifications du quartier épiscopal, à l’angle de la rue de Juniville et du boulevard-quai Kerguelen, en sont la preuve. Entièrement canalisé et souterrain, c’est d’ailleurs à cet endroit que se jette le second affluent de l’Odet, le Frout.
A lire aussi : Bretagne : le charme discret de Quimper
Neuf passerelles sur le fleuve
Dans le sillage de l’arrivée du train, la rive gauche accueille dès les années 1880 de belles maisons bourgeoises. Depuis leur jardin, chacune ou presque dispose d’une passerelle privative permettant de franchir l’Odet et de rejoindre le centre-ville.
L’aménagement en voie de circulation de la rive gauche va les désolidariser de leurs propriétés. Devenues publiques, neuf de ces passerelles, la plupart fleuries, impriment une touche romantique à ce secteur fluvial.
Le point d’orgue est atteint en 1903, avec la construction du théâtre Max Jacob. Restauré, il est de nos jours encadré par Novamax, espace dédié aux musiques actuelles et par le pôle Max Jacob, lieu d’expérimentation artistique ouvert à tous publics.
L’aménagement en voie de circulation de la rive gauche va les désolidariser de leurs propriétés. Devenues publiques, neuf de ces passerelles, la plupart fleuries, impriment une touche romantique à ce secteur fluvial.
Le point d’orgue est atteint en 1903, avec la construction du théâtre Max Jacob. Restauré, il est de nos jours encadré par Novamax, espace dédié aux musiques actuelles et par le pôle Max Jacob, lieu d’expérimentation artistique ouvert à tous publics.
Maison « Ty Kodak »
Une étape reste à évoquer. Elle date des années 1930 et concerne la rive droite. Les quais sont alors l’artère la plus élégante de la ville. Il faut voir et être vu ! Face au théâtre Max Jacob, des architectes bâtissent quelques bâtiments remarquables.
C’est le cas de la maison « Ty Kodak », bel exemple de style paquebot Art Déco, avec ses lignes courbes. L’immeuble date de 1933 et fut construit pour un photographe.
Mis bout à bout, les quais de l’Odet retracent l’itinéraire d’une ville qui continue de penser l’avenir avec son fleuve. En aval de Quimper, 64 000 habitants, Ville d’Art et d’Histoire et préfecture du Finistère, le port de Corniquel maintient une activité sablière.
Deux chantiers navals entretiennent la vocation marine. L’un, Ufast, construit des petits bateaux militaires. En face, le technopôle Quimper-Cornouaille lèche la rive gauche de l’Odet. Son pôle universitaire et son EMBA Business School s’inscrivent dans le futur. Quimper le voit plutôt marée montante.
A lire aussi : Brest, Quimper, Rennes, Saint-Malo, Vannes : à la découverte des grandes villes bretonnes
C’est le cas de la maison « Ty Kodak », bel exemple de style paquebot Art Déco, avec ses lignes courbes. L’immeuble date de 1933 et fut construit pour un photographe.
Mis bout à bout, les quais de l’Odet retracent l’itinéraire d’une ville qui continue de penser l’avenir avec son fleuve. En aval de Quimper, 64 000 habitants, Ville d’Art et d’Histoire et préfecture du Finistère, le port de Corniquel maintient une activité sablière.
Deux chantiers navals entretiennent la vocation marine. L’un, Ufast, construit des petits bateaux militaires. En face, le technopôle Quimper-Cornouaille lèche la rive gauche de l’Odet. Son pôle universitaire et son EMBA Business School s’inscrivent dans le futur. Quimper le voit plutôt marée montante.
A lire aussi : Brest, Quimper, Rennes, Saint-Malo, Vannes : à la découverte des grandes villes bretonnes























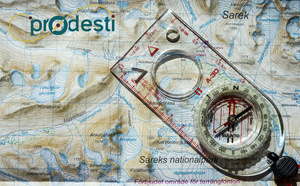










![Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93945726-65568018.jpg?v=1769613161)















