
La tradition perdure à Sainte-Croix : boites à musique, automates, oiseaux chanteurs, pendules anciennes, boites de gare. (DR CIMA)
Perchée entre 1000 et 1600m d’altitude la commune de Sainte-Croix est surnommée le balcon du Jura Vaudois.
C’est de là, dit on, que l’on peut avoir une des meilleures vues sur les Alpes et sur le lac de Neuchâtel. C’est également un paradis pour le ski de fond, la star de cet hiver.
Mais, c’est aussi dans cette cité qu’en 1865 Charles Reuge, horloger du Val Travers, s’installe et entreprend la fabrication des montres avec un mouvement à musique.
En 1886 il crée l’entreprise Reuge*. Dix ans après, une première manufacture, occupe 650 ouvriers à la confection de boites à musique.
C’est de là, dit on, que l’on peut avoir une des meilleures vues sur les Alpes et sur le lac de Neuchâtel. C’est également un paradis pour le ski de fond, la star de cet hiver.
Mais, c’est aussi dans cette cité qu’en 1865 Charles Reuge, horloger du Val Travers, s’installe et entreprend la fabrication des montres avec un mouvement à musique.
En 1886 il crée l’entreprise Reuge*. Dix ans après, une première manufacture, occupe 650 ouvriers à la confection de boites à musique.
Capitale mondiale
Et, en 1890 Sainte-Croix devient la capitale mondiale de boites à musique, jouant plus de 70 airs différents.
La fabrication se fait par milliers de pièces en original ou en série : boites à musique, automates, oiseaux chanteurs, pendules anciennes, boites de gare.
Les artisans, voire les artistes, de Sainte-Croix perpétuent aujourd’hui ce savoir-faire pointu reposant sur des exigences qualitatives. C’est à leur talent que l’UNESCO rend hommage en inscrivant leur « savoir faire en mécanique horlogère et mécanique d’art » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
C’est une belle reconnaissance pour ces métiers d’art parfois peu connus, mais c‘est encore une manière de les protéger.
La fabrication se fait par milliers de pièces en original ou en série : boites à musique, automates, oiseaux chanteurs, pendules anciennes, boites de gare.
Les artisans, voire les artistes, de Sainte-Croix perpétuent aujourd’hui ce savoir-faire pointu reposant sur des exigences qualitatives. C’est à leur talent que l’UNESCO rend hommage en inscrivant leur « savoir faire en mécanique horlogère et mécanique d’art » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
C’est une belle reconnaissance pour ces métiers d’art parfois peu connus, mais c‘est encore une manière de les protéger.
ADN de la région
Cette reconnaissance participe d’un mouvement plus large autour de la mécanique d’art qui voit, depuis plusieurs années, poindre un renouveau dans cette région.
La candidature a été le catalyseur qui a débouché sur plusieurs projets en cours de réalisation : le regroupement des collections des musées sous un seul toit, formation en mécanique d’art, la création d’un atelier de transmission du savoir-faire. Cette ambition s’inscrit dans une perspective commune, spécifique à Sainte-Croix : « la mécanique d’art : ADN de notre région ».
L’inscription est aussi le fruit d’une collaboration inter-cantonale (Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Jura) et internationale (région Bourgogne-Franche-Comté, Besançon) et elle est portée par les artisans, les musées, les écoles, et une vaste communauté d’amateurs ou de passionnés.
Ce savoir-faire est à découvrir au musée du centre international de la mécanique d’art (CIMA) qui met en scène une collection historique de boites à musique et d’automates ainsi qu’un atelier mécanique des années 1900 ,avec les machines d’époque.
En complément le musée Baud à l'Auberson présente une collection de pièces de musique mécanique. Une belle idée de voyage, ou de reportage (à lire dans TourMaG) quand les conditions sanitaires le permettront.
Croisons les doigts !
La candidature a été le catalyseur qui a débouché sur plusieurs projets en cours de réalisation : le regroupement des collections des musées sous un seul toit, formation en mécanique d’art, la création d’un atelier de transmission du savoir-faire. Cette ambition s’inscrit dans une perspective commune, spécifique à Sainte-Croix : « la mécanique d’art : ADN de notre région ».
L’inscription est aussi le fruit d’une collaboration inter-cantonale (Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Jura) et internationale (région Bourgogne-Franche-Comté, Besançon) et elle est portée par les artisans, les musées, les écoles, et une vaste communauté d’amateurs ou de passionnés.
Ce savoir-faire est à découvrir au musée du centre international de la mécanique d’art (CIMA) qui met en scène une collection historique de boites à musique et d’automates ainsi qu’un atelier mécanique des années 1900 ,avec les machines d’époque.
En complément le musée Baud à l'Auberson présente une collection de pièces de musique mécanique. Une belle idée de voyage, ou de reportage (à lire dans TourMaG) quand les conditions sanitaires le permettront.
Croisons les doigts !
*Installée à Sainte – Croix depuis plus de 150 ans la manufacture Reuge SA fait perdurer la tradition de fabrication avec des créations de mouvements mécaniques de précision et de prestige, très prisées des grands de ce monde, chefs d’Etats et têtes couronnées.
Le Patrimoine culturel immatériel
On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Il se distingue du patrimoine matériel qui consacre des sites.
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Il se distingue du patrimoine matériel qui consacre des sites.















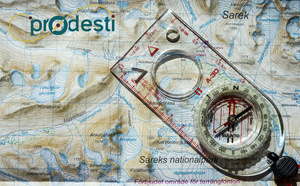









![Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/94117568-65653149.jpg?v=1770298665)





















