L’Institut Paris Region, en partenariat avec la Région Île-de-France, Choose Paris Region, la Métropole du Grand Paris et Voies Navigables de France, dévoile un nouveau carnet pratique consacré au tourisme fluvial et fluvestre.
L'objectif : révéler le potentiel des voies d’eau franciliennes en tant que vecteur d’un tourisme durable et inclusif.
Le document met en lumière une quarantaine d’initiatives locales qui conjuguent découverte du territoire, préservation de l’environnement et retombées économiques pour les communes riveraines.
Ce guide s’inscrit dans une dynamique régionale visant à structurer une offre touristique responsable autour de l’itinérance douce, du patrimoine culturel fluvial, des circuits courts et des activités de pleine nature.
L'objectif : révéler le potentiel des voies d’eau franciliennes en tant que vecteur d’un tourisme durable et inclusif.
Le document met en lumière une quarantaine d’initiatives locales qui conjuguent découverte du territoire, préservation de l’environnement et retombées économiques pour les communes riveraines.
Ce guide s’inscrit dans une dynamique régionale visant à structurer une offre touristique responsable autour de l’itinérance douce, du patrimoine culturel fluvial, des circuits courts et des activités de pleine nature.
Un patrimoine naturel sous-exploité
Autres articles
-
L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques
-
B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
-
Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes
-
Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie
-
L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
Avec ses 7 380 kilomètres de cours d’eau, dont 424 km de Seine, 242 km de Marne, ou encore 166 km de canaux, l’Île-de-France dispose d’un réseau fluvial dense mais encore peu valorisé à des fins touristiques.
On y recense environ 250 communes riveraines, ainsi qu’une trentaine de haltes fluviales, 35 ports de plaisance et une dizaine de péniches-hôtels.
Le développement du tourisme fluvestre, à la fois sur l’eau et sur les berges, constitue une opportunité de diversification de l’offre touristique francilienne.
Il permet également d’accroître la résilience des villes face aux épisodes climatiques extrêmes, tout en préservant les espaces de biodiversité.
On y recense environ 250 communes riveraines, ainsi qu’une trentaine de haltes fluviales, 35 ports de plaisance et une dizaine de péniches-hôtels.
Le développement du tourisme fluvestre, à la fois sur l’eau et sur les berges, constitue une opportunité de diversification de l’offre touristique francilienne.
Il permet également d’accroître la résilience des villes face aux épisodes climatiques extrêmes, tout en préservant les espaces de biodiversité.
Des projets concrets pour un tourisme engagé
Parmi les pratiques mises en avant dans le carnet, on retrouve :
- la renaturation des berges à Puteaux, intégrée à un programme de réinsertion professionnelle ;
- le développement de la Promenade de l’Orge dans l’Essonne, pensée dans une logique de continuité intercommunale ;
- le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy ;
- des actions de sensibilisation environnementale menées dans le Val-d’Oise ou encore à Asnières-sur-Seine.
L’ensemble de ces initiatives s’articule autour de quatre grands axes : améliorer le cadre de vie, protéger et sensibiliser à l’environnement, aménager les berges et accroître les retombées économiques locales.
Ce carnet se veut aussi un outil de concertation. Il encourage une coordination des acteurs publics et privés autour d’itinéraires fluviaux structurés, tout en tenant compte des enjeux de biodiversité et d’urbanisme.
- la renaturation des berges à Puteaux, intégrée à un programme de réinsertion professionnelle ;
- le développement de la Promenade de l’Orge dans l’Essonne, pensée dans une logique de continuité intercommunale ;
- le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy ;
- des actions de sensibilisation environnementale menées dans le Val-d’Oise ou encore à Asnières-sur-Seine.
L’ensemble de ces initiatives s’articule autour de quatre grands axes : améliorer le cadre de vie, protéger et sensibiliser à l’environnement, aménager les berges et accroître les retombées économiques locales.
Ce carnet se veut aussi un outil de concertation. Il encourage une coordination des acteurs publics et privés autour d’itinéraires fluviaux structurés, tout en tenant compte des enjeux de biodiversité et d’urbanisme.
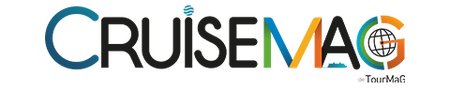








 Publié par Amelia Brille
Publié par Amelia Brille 











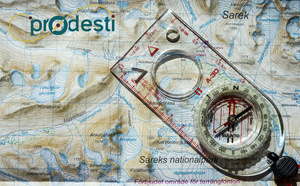










![Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93778464-65484235.jpg?v=1768841214)

















