Réalisée en mai 2025 par IPSOS pour l’Alliance France Tourisme, une enquête révèle que les Français, en dépit des incertitudes économiques et géopolitiques, maintiennent leur volonté de partir en vacances cet été.
Si 63 % associent cette période à un besoin d’évasion et 40 % à des retrouvailles familiales, les arbitrages budgétaires s’intensifient.
Parmi ceux qui envisagent de partir, 50 % en sont certains, tandis que 27 % restent indécis.
Si 63 % associent cette période à un besoin d’évasion et 40 % à des retrouvailles familiales, les arbitrages budgétaires s’intensifient.
Parmi ceux qui envisagent de partir, 50 % en sont certains, tandis que 27 % restent indécis.
Arbitrages budgétaires et aspirations contrastées des vacanciers
Autres articles
-
 France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
-
 Comité interministériel du tourisme : ce qu'il faut retenir
Comité interministériel du tourisme : ce qu'il faut retenir
-
 Tourisme : la France n’a jamais été le leader mondial, mais est-ce si grave ? [ABO]
Tourisme : la France n’a jamais été le leader mondial, mais est-ce si grave ? [ABO]
-
 100 milliards de parts de marché ? "Nous devons dépasser les logiques économiques et électoralistes" [ABO]
100 milliards de parts de marché ? "Nous devons dépasser les logiques économiques et électoralistes" [ABO]
-
 Alliance France Tourisme : saison estivale en dents de scie
Alliance France Tourisme : saison estivale en dents de scie
En 2025, le désir de vacances reste marqué chez les Français, mais s'accompagne d’une vigilance accrue sur les dépenses. Selon l’enquête, 50 % des répondants affirment leur intention ferme de partir au moins une semaine cet été, tandis que 27 % restent en attente de confirmation. En revanche, 23 % prévoient de ne pas partir du tout, un chiffre qui s’élève à 31 % dans les zones rurales, à 27 % chez les seniors et à 32 % parmi les foyers modestes.
Le budget moyen prévu pour les vacances est de 1 820 €, avec une répartition marquée : 31 % comptent dépenser moins de 1 000 €, 33 % entre 1 000 € et 2 000 €, et seulement 16 % plus de 3 000 €. Face à l’inflation, 39 % des vacanciers souhaitent réduire leur budget, notamment sur les dépenses jugées non essentielles comme les restaurants, le shopping ou les loisirs (70 %), et 30 % envisagent de raccourcir la durée de leur séjour.
Les motivations principales restent l’évasion (63 %), le bonheur (61 %) et la famille (40 %). Toutefois, 28 % font part d’inquiétudes budgétaires et 6 % jugent que l’organisation des vacances peut être une source de stress. Ces chiffres reflètent une tension entre le besoin de déconnexion et les contraintes économiques, obligeant les Français à ajuster leurs projets tout en préservant l’essentiel de leur été.
Le budget moyen prévu pour les vacances est de 1 820 €, avec une répartition marquée : 31 % comptent dépenser moins de 1 000 €, 33 % entre 1 000 € et 2 000 €, et seulement 16 % plus de 3 000 €. Face à l’inflation, 39 % des vacanciers souhaitent réduire leur budget, notamment sur les dépenses jugées non essentielles comme les restaurants, le shopping ou les loisirs (70 %), et 30 % envisagent de raccourcir la durée de leur séjour.
Les motivations principales restent l’évasion (63 %), le bonheur (61 %) et la famille (40 %). Toutefois, 28 % font part d’inquiétudes budgétaires et 6 % jugent que l’organisation des vacances peut être une source de stress. Ces chiffres reflètent une tension entre le besoin de déconnexion et les contraintes économiques, obligeant les Français à ajuster leurs projets tout en préservant l’essentiel de leur été.
Tourisme local, nouvelles pratiques et préférences générationnelles
La France demeure la destination privilégiée pour 68 % des vacanciers, un choix particulièrement affirmé chez les 55-75 ans (74 %). L’Europe attire 26 % des futurs voyageurs, surtout parmi les 18-34 ans (34 %), et 13 % prévoient des séjours hors Europe. Le transport principal reste la voiture (61 %), notamment pour les voyages domestiques (72 %), tandis que l’avion est utilisé pour les trajets vers l’Europe (55 %) et au-delà (90 %). Le train concerne 18 % des déplacements, atteignant 28 % chez les plus jeunes.
Les hébergements les plus recherchés sont les locations saisonnières (39 %), suivies des hôtels (26 %) et de l’hébergement chez des proches (20 %). Le camping conserve une place stable (17 %), surtout en France (21 %). De nouvelles formes de vacances s’installent dans les habitudes : 24 % des sondés envisagent le "workation", avec un taux de 45 % chez les 18-34 ans. Les mini-breaks séduisent 13 % des vacanciers, particulièrement les CSP+ et les hauts revenus. En revanche, des pratiques comme le Couchsurfing ou l’échange de maisons restent minoritaires.
Sur le plan symbolique, les destinations idéales évoquent plages paradisiaques (28 %), nature (23 %) et croisières (20 %). Certains se projettent dans l’univers de "Mamma Mia !" (17 %) ou du film "Camping" (16 %). Les craintes les plus fréquentes concernent les arnaques (73 %), les conditions météo (35 %), un budget insuffisant (21 %) et les problèmes de transport (19 %). Pour l’Alliance France Tourisme, cette enquête traduit « la flexibilité, la quête d’authenticité et la capacité de résilience » des Français, dans un été qui s’annonce sous le signe de l’adaptation.
Les hébergements les plus recherchés sont les locations saisonnières (39 %), suivies des hôtels (26 %) et de l’hébergement chez des proches (20 %). Le camping conserve une place stable (17 %), surtout en France (21 %). De nouvelles formes de vacances s’installent dans les habitudes : 24 % des sondés envisagent le "workation", avec un taux de 45 % chez les 18-34 ans. Les mini-breaks séduisent 13 % des vacanciers, particulièrement les CSP+ et les hauts revenus. En revanche, des pratiques comme le Couchsurfing ou l’échange de maisons restent minoritaires.
Sur le plan symbolique, les destinations idéales évoquent plages paradisiaques (28 %), nature (23 %) et croisières (20 %). Certains se projettent dans l’univers de "Mamma Mia !" (17 %) ou du film "Camping" (16 %). Les craintes les plus fréquentes concernent les arnaques (73 %), les conditions météo (35 %), un budget insuffisant (21 %) et les problèmes de transport (19 %). Pour l’Alliance France Tourisme, cette enquête traduit « la flexibilité, la quête d’authenticité et la capacité de résilience » des Français, dans un été qui s’annonce sous le signe de l’adaptation.
Vacances de printemps et ponts de mai 2025
L’Observatoire économique de l’Alliance France Tourisme publie également son analyse sur la fréquentation touristique entre mars et mai 2025, période incluant les vacances de printemps et les ponts du 1er et du 8 mai. Cette période, souvent considérée comme un indicateur des tendances estivales à venir, révèle une forte envie de départ, tout en soulignant les contraintes économiques qui pèsent sur les comportements de voyage. Selon les données recueillies, 57 % des Français ont voyagé sur cette période, soit une progression de trois points par rapport à 2024. Toutefois, les déplacements sont majoritairement de courte durée.
Le tourisme domestique reste largement dominant, avec près de 70 % des séjours réalisés en France. Le littoral et les zones rurales enregistrent une hausse de fréquentation de 4,2 % par rapport à l’an dernier. À l’inverse, certaines métropoles rencontrent des difficultés hors temps forts événementiels. Les zones de montagne ont profité de la neige encore présente début avril, avant de céder leur place en mai aux destinations côtières. Concernant les week-ends prolongés, une meilleure répartition des départs a été observée. Cela se traduit par une hausse de 6 points du taux d’occupation pour le week-end du 1er mai, mais une baisse de 7 points pour celui du 8 mai, en comparaison avec l’année précédente.
Les contrastes territoriaux sont marqués. Paris affiche une hausse de fréquentation de 5 points par rapport à 2024, où un certain attentisme pré-Jeux Olympiques était observé. Le littoral de la Manche (+25 %) et la façade atlantique (+11 %) bénéficient d’un chiffre d’affaires en nette augmentation durant les vacances de Pâques, favorisé par des conditions météorologiques favorables. En mai, la Côte d’Azur (+17 %) et les espaces ruraux (+18 %) ont été les principaux bénéficiaires des ponts. En revanche, les destinations d’outre-mer comme La Réunion ou la Martinique enregistrent une baisse, liée à l’augmentation des prix du transport aérien et aux arbitrages budgétaires des ménages.
D’autres tendances ressortent : les zones comme le Massif central ou le centre de la France attirent une nouvelle clientèle à la recherche de séjours axés sur la nature et le slow tourisme. Concernant les acteurs du secteur, seuls 9 % des vacanciers ont eu recours à un tour-opérateur ou une agence, un taux stable mais en recul pour les séjours moyen-courrier. L’activité des TO est désormais tirée par les destinations long-courrier ou à bas coût, notamment hors zone euro. Enfin, les contraintes économiques demeurent prégnantes : 39 % des vacanciers déclarent avoir restreint leur budget, avec un montant moyen par séjour de 812 €, en baisse de 5 %, pour une durée moyenne de 4,2 nuits. Le recours à l’hébergement non marchand atteint un niveau inédit de 42 %, illustrant l’adaptation des pratiques à un contexte économique contraint.
Le tourisme domestique reste largement dominant, avec près de 70 % des séjours réalisés en France. Le littoral et les zones rurales enregistrent une hausse de fréquentation de 4,2 % par rapport à l’an dernier. À l’inverse, certaines métropoles rencontrent des difficultés hors temps forts événementiels. Les zones de montagne ont profité de la neige encore présente début avril, avant de céder leur place en mai aux destinations côtières. Concernant les week-ends prolongés, une meilleure répartition des départs a été observée. Cela se traduit par une hausse de 6 points du taux d’occupation pour le week-end du 1er mai, mais une baisse de 7 points pour celui du 8 mai, en comparaison avec l’année précédente.
Les contrastes territoriaux sont marqués. Paris affiche une hausse de fréquentation de 5 points par rapport à 2024, où un certain attentisme pré-Jeux Olympiques était observé. Le littoral de la Manche (+25 %) et la façade atlantique (+11 %) bénéficient d’un chiffre d’affaires en nette augmentation durant les vacances de Pâques, favorisé par des conditions météorologiques favorables. En mai, la Côte d’Azur (+17 %) et les espaces ruraux (+18 %) ont été les principaux bénéficiaires des ponts. En revanche, les destinations d’outre-mer comme La Réunion ou la Martinique enregistrent une baisse, liée à l’augmentation des prix du transport aérien et aux arbitrages budgétaires des ménages.
D’autres tendances ressortent : les zones comme le Massif central ou le centre de la France attirent une nouvelle clientèle à la recherche de séjours axés sur la nature et le slow tourisme. Concernant les acteurs du secteur, seuls 9 % des vacanciers ont eu recours à un tour-opérateur ou une agence, un taux stable mais en recul pour les séjours moyen-courrier. L’activité des TO est désormais tirée par les destinations long-courrier ou à bas coût, notamment hors zone euro. Enfin, les contraintes économiques demeurent prégnantes : 39 % des vacanciers déclarent avoir restreint leur budget, avec un montant moyen par séjour de 812 €, en baisse de 5 %, pour une durée moyenne de 4,2 nuits. Le recours à l’hébergement non marchand atteint un niveau inédit de 42 %, illustrant l’adaptation des pratiques à un contexte économique contraint.









 Publié par Manon Morelli
Publié par Manon Morelli 
















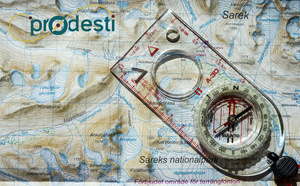










![Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93852662-65524623.jpg?v=1769430482)

















