Génolhac, ancienne autoroute marchande
La cité du Gard conserve la mémoire de deux périodes clés : le chemin commerçant de la Régordane et la lutte fratricide entre catholiques et protestants cévenols.
Son architecture disparate et peu restaurée ne plaide pas en sa faveur. Mais le village conserve des vestiges intéressants et témoigne d’une double histoire : ancienne ville-étape sur le Chemin de la Régordane, il fut aussi un haut lieu de la révolte des Camisards.
Génolhac a profité d’une position favorable sur un axe majeur de commerce et de pèlerinage dès le Moyen Âge.
Ce chemin de la Régordane, très fréquenté du 10e s. au 13e s., reliait le royaume de France au Languedoc, depuis le Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Gilles. Marchands et pèlerins faisaient halte ici dans des hostelleries.
Des maisons souvent dotées d’un double porche, l’un pour rentrer la charrue ou les bêtes, l’autre, plus petit, pour accéder au logis - on peut en voir une typique sous le couvert qui enjambe la traverse de la Croix Blanche.
Son architecture disparate et peu restaurée ne plaide pas en sa faveur. Mais le village conserve des vestiges intéressants et témoigne d’une double histoire : ancienne ville-étape sur le Chemin de la Régordane, il fut aussi un haut lieu de la révolte des Camisards.
Génolhac a profité d’une position favorable sur un axe majeur de commerce et de pèlerinage dès le Moyen Âge.
Ce chemin de la Régordane, très fréquenté du 10e s. au 13e s., reliait le royaume de France au Languedoc, depuis le Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Gilles. Marchands et pèlerins faisaient halte ici dans des hostelleries.
Des maisons souvent dotées d’un double porche, l’un pour rentrer la charrue ou les bêtes, l’autre, plus petit, pour accéder au logis - on peut en voir une typique sous le couvert qui enjambe la traverse de la Croix Blanche.
Entre Massif Central et Méditerranée
Autres articles
-
 Le camping champion d’Europe du tourisme durable est français !
Le camping champion d’Europe du tourisme durable est français !
-
 Du Pont du Gard aux citadelles du vertige cathares, innombrables empreintes de l’Histoire
Du Pont du Gard aux citadelles du vertige cathares, innombrables empreintes de l’Histoire
-
 Saint-André-de-Valborgne : quand le Maire fait le buzz en faisant la leçon aux touristes...
Saint-André-de-Valborgne : quand le Maire fait le buzz en faisant la leçon aux touristes...
-
 Le Parc National des Cévennes devient une Réserve internationale de ciel étoilé
Le Parc National des Cévennes devient une Réserve internationale de ciel étoilé
-
 Le Pont du Gard allume les projecteurs sur Pierre Parsus
Le Pont du Gard allume les projecteurs sur Pierre Parsus
Sur les façades, les maisons de la Grande Rue (ou rue Droite, là où passait le chemin de la Régordane) et de la rue Soubeyranne portent la trace des fortunes passées : sculptures de personnages ou d’animaux ; linteaux datés ou représentant un statut, commerçant, artisan, bourgeois…
Les deux rues se trouvaient à l’intérieur de remparts, dont l’accès s’effectuait par deux portes.
Dans le « rectangle » de cette vieille ville, des couverts abritaient le marché. L’un subsiste à l’angle de la Grande Rue et de la rue de l’Arceau.
A l’époque, Génolhac était une autoroute marchande : depuis le Gévaudan et le Massif Central, des convois de mulets et de charrettes chargés de viande, bois, seigle, châtaignes ou tissus de laine croisaient ceux qui depuis la Méditerranée remontaient sel, soie, huile d’olive, vin…
Les deux rues se trouvaient à l’intérieur de remparts, dont l’accès s’effectuait par deux portes.
Dans le « rectangle » de cette vieille ville, des couverts abritaient le marché. L’un subsiste à l’angle de la Grande Rue et de la rue de l’Arceau.
A l’époque, Génolhac était une autoroute marchande : depuis le Gévaudan et le Massif Central, des convois de mulets et de charrettes chargés de viande, bois, seigle, châtaignes ou tissus de laine croisaient ceux qui depuis la Méditerranée remontaient sel, soie, huile d’olive, vin…
La révolte des Camisards
Un peu plus loin, la ruelle des Dragons de Villars dévale sous un passage voûté vers la Gardonnette, torrent cévenol descendu du mont Lozère.
Le nom du passage rappelle une autre période de l’histoire de Génolhac : la présence de soldats du Roi dépêchés dans les Cévennes au début du 18e s. pour mater la révolte des Camisards.
Parmi ces protestants irréductibles, leur chef local, Nicolas Jouany, brûlera l’église en 1702 et détruira le couvent de Dominicains au début de l’année 1703.
Temple et nouvelle église cohabitent toujours sur cette terre qui accueillait encore en 2002 deux boucheries : l’une tenu par un catholique ; l’autre par un protestant. Tout un symbole.
Le nom du passage rappelle une autre période de l’histoire de Génolhac : la présence de soldats du Roi dépêchés dans les Cévennes au début du 18e s. pour mater la révolte des Camisards.
Parmi ces protestants irréductibles, leur chef local, Nicolas Jouany, brûlera l’église en 1702 et détruira le couvent de Dominicains au début de l’année 1703.
Temple et nouvelle église cohabitent toujours sur cette terre qui accueillait encore en 2002 deux boucheries : l’une tenu par un catholique ; l’autre par un protestant. Tout un symbole.
Saint-Jean-du-Gard, au fil de soie
D’esprit méridional, le village rappelle au travers de son « Musée Rouge », le particularisme de l’âme cévenole, façonnée par les filatures de soie et le protestantisme. Un arrêt obligé pour mieux cerner l’identité de la région.
Se balader dans les rues de Saint-Jean-du-Gard un mardi, jour de marché, c’est l’assurance de mettre un peu de Provence dans les yeux. Etals colorés, produits de saison, terrasses de bars de la Tour de l’Horloge remplies… pas de doute, le Sud est là !
Mais son identité est autre. On le ressent en entrant dans le temple de l’Eglise protestante unie de France, place Carnot.
« Si on veut vivre à Saint-Jean-du-Gard, on est obligé de prendre la religion en compte. C’est ce que m’ont dit des gens d’ici lorsque j’ai choisi d’y habiter », se souvient Jocelyne, père cévenol protestant, mère provençale catholique.
A côté d’elle, sur le seuil du temple, Nelly, fille de pasteur et ex-prof d’histoire-géographie, éclaire le débat à sa manière. « Les catholiques font des œuvres pour gagner le paradis. Les protestants sont plus volontaristes et veulent changer le monde », dit cette dynamique retraitée.
Ville historiquement combative (avec jardins partagés, accueil de migrants, épicerie solidaire…), Saint-Jean-du-Gard abrite plusieurs obédiences et œuvres protestantes, l’Armée du Salut, l’Eglise Evangélique Libre, l’Eglise Evangélique de Pentecôte.
Se balader dans les rues de Saint-Jean-du-Gard un mardi, jour de marché, c’est l’assurance de mettre un peu de Provence dans les yeux. Etals colorés, produits de saison, terrasses de bars de la Tour de l’Horloge remplies… pas de doute, le Sud est là !
Mais son identité est autre. On le ressent en entrant dans le temple de l’Eglise protestante unie de France, place Carnot.
« Si on veut vivre à Saint-Jean-du-Gard, on est obligé de prendre la religion en compte. C’est ce que m’ont dit des gens d’ici lorsque j’ai choisi d’y habiter », se souvient Jocelyne, père cévenol protestant, mère provençale catholique.
A côté d’elle, sur le seuil du temple, Nelly, fille de pasteur et ex-prof d’histoire-géographie, éclaire le débat à sa manière. « Les catholiques font des œuvres pour gagner le paradis. Les protestants sont plus volontaristes et veulent changer le monde », dit cette dynamique retraitée.
Ville historiquement combative (avec jardins partagés, accueil de migrants, épicerie solidaire…), Saint-Jean-du-Gard abrite plusieurs obédiences et œuvres protestantes, l’Armée du Salut, l’Eglise Evangélique Libre, l’Eglise Evangélique de Pentecôte.
Musée passionnant...
Ce tempérament, elle le doit aussi à ses anciennes usines. « Dans les années 1850, il y a eu plus de vingt établissements travaillant la soie à Saint-Jean-du-Gard », rappelle Valérie Dumont-Escojido, responsable du marketing pour les musées d’Alès Agglomération.
Nous sommes au Musée Rouge, une ex-filature fondée au début du 19e s., devenue la mémoire de l’identité cévenole. Le bâtiment, classé, a fonctionné jusqu’en 1965, dernière filature de soie en France.
Depuis 2017, il abrite ce musée passionnant qui retrace l’activité de l’usine et celle des métiers cévenols, l’agriculture, l’artisanat, les foires et les marchés, la vie domestique, l’habitat…
« La Maison Rouge a été la première à utiliser la vapeur. On fabriquait ici le fil de soie en dévidant les cocons élevés dans les magnaneries. Le fil partait ensuite dans le Lyonnais pour le tissage textile ou restait dans les Cévennes pour la fabrique de bas », éclaire Valérie Dumont-Escojido.
Nous sommes au Musée Rouge, une ex-filature fondée au début du 19e s., devenue la mémoire de l’identité cévenole. Le bâtiment, classé, a fonctionné jusqu’en 1965, dernière filature de soie en France.
Depuis 2017, il abrite ce musée passionnant qui retrace l’activité de l’usine et celle des métiers cévenols, l’agriculture, l’artisanat, les foires et les marchés, la vie domestique, l’habitat…
« La Maison Rouge a été la première à utiliser la vapeur. On fabriquait ici le fil de soie en dévidant les cocons élevés dans les magnaneries. Le fil partait ensuite dans le Lyonnais pour le tissage textile ou restait dans les Cévennes pour la fabrique de bas », éclaire Valérie Dumont-Escojido.
Communauté féminine des filatures
Travail pénible, dans des conditions strictes, et solidarité ouvrière : le musée évoque cette communauté féminine dure au mal.
A l’époque, il fallait 75 kg de cocons pour faire 5 kg de fil de soie. « La maladie des muriers et l’arrivée du nylon ont provoqué le déclin de l’activité », dit la responsable.
Mais pas celui du temps passé, superbement mis en scène dans cet écrin muséal.
A l’époque, il fallait 75 kg de cocons pour faire 5 kg de fil de soie. « La maladie des muriers et l’arrivée du nylon ont provoqué le déclin de l’activité », dit la responsable.
Mais pas celui du temps passé, superbement mis en scène dans cet écrin muséal.
La Garde-Guérin, qui va là ?

Le village lozérien de La Garde-Guérin joua un rôle protecteur dès le 12e s. Sa tour de garde et ses ruelles empierrées rappellent ce rôle médiéval - Photo : J.-F.R.
Assurant la sécurité des voyageurs sur le Chemin de la Regordane, infesté de « routiers » pillards au Moyen Âge, le village lozérien de La Garde-Guérin joua un rôle protecteur dès le 12e s. Sa tour de garde et ses ruelles empierrées rappellent ce rôle médiéval.
Une apparition sur le plateau désert.
Là où on n’imaginerait pas qu’un village puisse se déployer surgit un bourg moyenâgeux, tel un décor de cinéma.
Des ruelles empierrées, des maisons de chevaliers aux toits de schiste, une tour de garde conquérante, des remparts, un four à pain… « Le village, agricole, a été entièrement rebâti dans les années 1970. De là vient son renouveau et son attrait touristique », indique Marie-Hélène Landrieu, présidente de GARDE, l’association qui concourt à son développement.
La Garde-Guérin est née de l’existence du Chemin de la Regordane, voie marchande et religieuse tracée entre Languedoc et Auvergne à travers les Cévennes.
Un axe à risques, dont la portion située entre Villefort et la Bastide était considérée comme la plus dangereuse. Des mercenaires voleurs et incendiaires - quand ce n’était pas pire… -, les « routiers », faisaient régner une menace permanente sur les voyageurs.
Une apparition sur le plateau désert.
Là où on n’imaginerait pas qu’un village puisse se déployer surgit un bourg moyenâgeux, tel un décor de cinéma.
Des ruelles empierrées, des maisons de chevaliers aux toits de schiste, une tour de garde conquérante, des remparts, un four à pain… « Le village, agricole, a été entièrement rebâti dans les années 1970. De là vient son renouveau et son attrait touristique », indique Marie-Hélène Landrieu, présidente de GARDE, l’association qui concourt à son développement.
La Garde-Guérin est née de l’existence du Chemin de la Regordane, voie marchande et religieuse tracée entre Languedoc et Auvergne à travers les Cévennes.
Un axe à risques, dont la portion située entre Villefort et la Bastide était considérée comme la plus dangereuse. Des mercenaires voleurs et incendiaires - quand ce n’était pas pire… -, les « routiers », faisaient régner une menace permanente sur les voyageurs.
Une place forte
Dès le 10e s., des seigneurs locaux s’enquièrent de la sécurité sur cet axe et bâtissent des places fortes.
La Garde-Guérin nait de cette nécessité, au cœur d’un plateau à 900 mètres d’altitude, dominant les gorges du Chassezac - le site est superbe.
Plusieurs fois attaqués, La Garde-Guérin et le Chemin de la Régordane étaient défendus par la corporation des Chevaliers Pariers, une communauté née sous l’impulsion des barons locaux. Chacun possédait une « parérie », soit une part du village fortifié ainsi qu’une portion du chemin.
En échange de leur protection, voyageurs et marchands devaient payer des taxes : droit de péage et de guidage ; droit de cartelage pour la mesure des grains produits sur leur domaine ; droit de pulvérage pour la poussière que soulevaient les troupeaux au passage…
Certains linteaux de portes ou de porches affichent encore la mention PG, pour « Parier de la Garde ».
La Garde-Guérin nait de cette nécessité, au cœur d’un plateau à 900 mètres d’altitude, dominant les gorges du Chassezac - le site est superbe.
Plusieurs fois attaqués, La Garde-Guérin et le Chemin de la Régordane étaient défendus par la corporation des Chevaliers Pariers, une communauté née sous l’impulsion des barons locaux. Chacun possédait une « parérie », soit une part du village fortifié ainsi qu’une portion du chemin.
En échange de leur protection, voyageurs et marchands devaient payer des taxes : droit de péage et de guidage ; droit de cartelage pour la mesure des grains produits sur leur domaine ; droit de pulvérage pour la poussière que soulevaient les troupeaux au passage…
Certains linteaux de portes ou de porches affichent encore la mention PG, pour « Parier de la Garde ».
Boutiques d’artisans
La balade dans les ruelles transporte au Moyen Âge - les visites guidées organisées par GARDE sont à recommander.
On découvre le charme des ruelles à rigole centrale, bordées de quelques boutiques d’artisans. On observe les vestiges d’un château du 16e s.
On grimpe (avec acrobatie !) au sommet de la tour de garde, ouvrant la vue sur la forêt de toits et le canyon du Chassezac.
On visite l’adorable église romane du 13e s. et son clocher à peigne. On se dit au final que la restauration n’a pas dénaturé l’esprit de ce village, un peu musée peut-être mais encore vibrant de son tempérament médiéval.
Lire aussi : L’Ardèche, entre Cévennes et Provence
On découvre le charme des ruelles à rigole centrale, bordées de quelques boutiques d’artisans. On observe les vestiges d’un château du 16e s.
On grimpe (avec acrobatie !) au sommet de la tour de garde, ouvrant la vue sur la forêt de toits et le canyon du Chassezac.
On visite l’adorable église romane du 13e s. et son clocher à peigne. On se dit au final que la restauration n’a pas dénaturé l’esprit de ce village, un peu musée peut-être mais encore vibrant de son tempérament médiéval.
Lire aussi : L’Ardèche, entre Cévennes et Provence
Pratique
Hébergement/restauration
- Hôtel-restaurant Le Pradinas, à Mialet
Bel établissement familial en pierre du pays, au calme.
- Auberge La Régordane, à La Garde-Guérin
Aménagée dans une demeure seigneuriale du 16e s.
Visiter
Musée du Désert, à Mialet
Acheter
Comptoir de la Régordane, à La Garde-Guérin
Grande boutique coopérative de produits régionaux et artisanaux, avec restaurant à midi.
- Hôtel-restaurant Le Pradinas, à Mialet
Bel établissement familial en pierre du pays, au calme.
- Auberge La Régordane, à La Garde-Guérin
Aménagée dans une demeure seigneuriale du 16e s.
Visiter
Musée du Désert, à Mialet
Acheter
Comptoir de la Régordane, à La Garde-Guérin
Grande boutique coopérative de produits régionaux et artisanaux, avec restaurant à midi.






















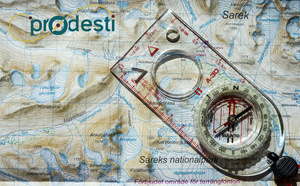










![Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93778464-65484235.jpg?v=1768841214)















