
L’amphithéâtre de Grand, construit vers l’an 80, était au 3e rang des édifices de la Gaule avec 18 000 places - Crédit photo : OT des Vosges
Domrémy : un nom qui résonne comme trois petites notes de musique d’un début de gamme.
Lié à jamais à Jeanne d’Arc, son héroïne, cette commune des Vosges est de celles que l’on n’oublie pas.
C’est ici que Jeanne la bonne Lorraine dit avoir « entendu des voix dans le jardin de son père ». D’où sa détermination à prendre les armes pour son roi.
Nos maitres d’écoles nous ont conté le destin tragique de cette jeune héroïne, malgré elle, qui bouta les Anglais hors de France. Ce qui permit notamment à Charles VII, monarque d’un royaume éclaté, de se faire sacrer à Reims en 1429.
Cette épopée est évoquée ici, à Domrémy-la-Pucelle, à travers trois lieux symboliques : la maison natale, le centre d’interprétation et la petite église.
Agrandie, remaniée maintes fois et remise a l’état initial, la maison de Jeanne d’Arc a été achetée par le département des Vosges en 1818. Par patriotisme, son propriétaire, Nicolas Guérin, un vieux grognard de Napoléon a refusé de la vendre à un comte prussien qui, pourtant, triplait la mise.
Composée de quatre pièces simples, de conception sobre, abritées sous un toit en appentis, la maison natale présente un aspect discret mais témoigne d’un relatif confort pour l’époque avec des fenêtres à meneaux et une belle cheminée de pierre.
Un arc surmonte la porte d’entrée et encadre un écusson aux armes de la famille et de la France accompagné d’une inscription « Vive le labeur, vive le Roi ».
Ce qui, contrairement aux idées reçues, montre le niveau de vie relativement élevé de cette famille de laboureurs mais aussi propriétaires terriens, possédant une trentaine d’hectares de bois et prés.
De l’autre côté de la rue, on trouve l’église du bourg, une construction gothique du XIVe siècle qui a conservé sa tour d’origine.
L’édifice renferme notamment la baignoire de pierre où Jeanne a été baptisée, une statue de Sainte Marguerite, une intéressante peinture murale du martyr de Saint Sébastien et la pierre tombale de Jacob et Didier Thiesselin, témoins au procès de réhabilitation.
Face à l’église, le musée Johannique complète la visite avec un bric à brac d’objets se rapportant à la Sainte.
A l’arrière de la maison natale, le Centre d’interprétation permet d’esquisser un portrait plus achevé de Jeanne d’Arc en traitant plusieurs aspects de son enfance domrémoise, de sa vie mais encore des réappropriations contemporaines.
A un jet de là, il est impossible de louper la basilique du Bois-Chenu qui domine le paysage. C’est là, dit-on, que Jeanne a entendu des voix.
Lié à jamais à Jeanne d’Arc, son héroïne, cette commune des Vosges est de celles que l’on n’oublie pas.
C’est ici que Jeanne la bonne Lorraine dit avoir « entendu des voix dans le jardin de son père ». D’où sa détermination à prendre les armes pour son roi.
Nos maitres d’écoles nous ont conté le destin tragique de cette jeune héroïne, malgré elle, qui bouta les Anglais hors de France. Ce qui permit notamment à Charles VII, monarque d’un royaume éclaté, de se faire sacrer à Reims en 1429.
Cette épopée est évoquée ici, à Domrémy-la-Pucelle, à travers trois lieux symboliques : la maison natale, le centre d’interprétation et la petite église.
Agrandie, remaniée maintes fois et remise a l’état initial, la maison de Jeanne d’Arc a été achetée par le département des Vosges en 1818. Par patriotisme, son propriétaire, Nicolas Guérin, un vieux grognard de Napoléon a refusé de la vendre à un comte prussien qui, pourtant, triplait la mise.
Composée de quatre pièces simples, de conception sobre, abritées sous un toit en appentis, la maison natale présente un aspect discret mais témoigne d’un relatif confort pour l’époque avec des fenêtres à meneaux et une belle cheminée de pierre.
Un arc surmonte la porte d’entrée et encadre un écusson aux armes de la famille et de la France accompagné d’une inscription « Vive le labeur, vive le Roi ».
Ce qui, contrairement aux idées reçues, montre le niveau de vie relativement élevé de cette famille de laboureurs mais aussi propriétaires terriens, possédant une trentaine d’hectares de bois et prés.
De l’autre côté de la rue, on trouve l’église du bourg, une construction gothique du XIVe siècle qui a conservé sa tour d’origine.
L’édifice renferme notamment la baignoire de pierre où Jeanne a été baptisée, une statue de Sainte Marguerite, une intéressante peinture murale du martyr de Saint Sébastien et la pierre tombale de Jacob et Didier Thiesselin, témoins au procès de réhabilitation.
Face à l’église, le musée Johannique complète la visite avec un bric à brac d’objets se rapportant à la Sainte.
A l’arrière de la maison natale, le Centre d’interprétation permet d’esquisser un portrait plus achevé de Jeanne d’Arc en traitant plusieurs aspects de son enfance domrémoise, de sa vie mais encore des réappropriations contemporaines.
A un jet de là, il est impossible de louper la basilique du Bois-Chenu qui domine le paysage. C’est là, dit-on, que Jeanne a entendu des voix.
Grand : la gallo-romaine mystérieuse

La mosaïque de la cité antique de Grand se présente dans un remarquable état de conservation - Crédit photo : OT des Vosges
Autres articles
-
 5 incontournables dans les Hautes-Vosges : entre sapins de Noël et sports d’hiver
5 incontournables dans les Hautes-Vosges : entre sapins de Noël et sports d’hiver
-
 Vosges du Nord : voyage au pays des verriers
Vosges du Nord : voyage au pays des verriers
-
 Voyages Vert Vous - L'Alsace Verte, reconnexion avec son patrimoine vivant (EP16)
Voyages Vert Vous - L'Alsace Verte, reconnexion avec son patrimoine vivant (EP16)
-
 Tour de France : Couleur Monde, une agence au sommet... des Vosges !
Tour de France : Couleur Monde, une agence au sommet... des Vosges !
-
 Couleur Monde : le bonheur... et le voyage sont dans le pré !
Couleur Monde : le bonheur... et le voyage sont dans le pré !
C’est en jouant dans le village de Grand que des enfants ont découvert un mur de pierres dans les années 60.
En réalité, ils s’amusaient, sans le savoir, sur un vestige du mur d’enceinte d’une cité antique de plus de 10 000 âmes.
Intrigués, archéologues et chercheurs ont découvert dans leurs fouilles un exceptionnel site romain : vestiges de bâtiments publics, de thermes, constructions privées et les décombres de canalisation qui ravitaillent les bassins sacrés.
Joyau de l’endroit, la mosaïque (IIIe siècle) - un chef-d’œuvre de 232 m2 - se présente dans un remarquable état de conservation. Enfin, l’amphithéâtre construit vers l’an 80, était au 3e rang des édifices de la Gaule avec 18 000 places - soit la capacité d’un beau stade du Top 14 de rugby !
Grand peut se classer parmi les grands sites romains, surtout depuis que l’on sait qu’il reste encore de nombreux secrets enfouis.
En réalité, ils s’amusaient, sans le savoir, sur un vestige du mur d’enceinte d’une cité antique de plus de 10 000 âmes.
Intrigués, archéologues et chercheurs ont découvert dans leurs fouilles un exceptionnel site romain : vestiges de bâtiments publics, de thermes, constructions privées et les décombres de canalisation qui ravitaillent les bassins sacrés.
Joyau de l’endroit, la mosaïque (IIIe siècle) - un chef-d’œuvre de 232 m2 - se présente dans un remarquable état de conservation. Enfin, l’amphithéâtre construit vers l’an 80, était au 3e rang des édifices de la Gaule avec 18 000 places - soit la capacité d’un beau stade du Top 14 de rugby !
Grand peut se classer parmi les grands sites romains, surtout depuis que l’on sait qu’il reste encore de nombreux secrets enfouis.
Théâtre du peuple à Bussang
Du gigantesque amphi, passons à l’insolite Théâtre du peuple à Bussang.
A la source de la Moselle, dans un décor sublime, le petit bourg doit sa célébrité à son singulier théâtre créé à la fin du XIXe siècle.
Enfant du pays, Maurice Pottecher eut l’idée de renouer avec un théâtre rural et populaire. Avec l’aide des façonniers locaux, il bâtit un édifice tout en bois du pays, à l’opposé des riches théâtres de l’époque.
Et, en tirant le rideau, la scène s’ouvrait non sur un décor peint, mais sur une forêt bien réelle qui invite à entrer dans son univers.
Il confia les rôles aux autochtones, écrivit des pièces puisées dans les contes et légendes locales et la vie paysanne. La première du Diable marchand de goutte rencontra un succès triomphal. Les autres pièces ont suivi et la renommée aussi.
Si bien que l’initiative fut saluée par des célébrités de l’époque comme Louis Jouvet, Anatole France ou Léon Tolstoï notamment.
130 ans après, la scène est toujours ouverte sur la futaie, les comédiens amateurs et professionnels sont toujours bénévoles et le public est toujours au rendez vous. 18 000 spectateurs sont venus à Bussang en 2025 pour assister aux représentations.
Lire aussi : Vosges du Nord : voyage au pays des verriers
A la source de la Moselle, dans un décor sublime, le petit bourg doit sa célébrité à son singulier théâtre créé à la fin du XIXe siècle.
Enfant du pays, Maurice Pottecher eut l’idée de renouer avec un théâtre rural et populaire. Avec l’aide des façonniers locaux, il bâtit un édifice tout en bois du pays, à l’opposé des riches théâtres de l’époque.
Et, en tirant le rideau, la scène s’ouvrait non sur un décor peint, mais sur une forêt bien réelle qui invite à entrer dans son univers.
Il confia les rôles aux autochtones, écrivit des pièces puisées dans les contes et légendes locales et la vie paysanne. La première du Diable marchand de goutte rencontra un succès triomphal. Les autres pièces ont suivi et la renommée aussi.
Si bien que l’initiative fut saluée par des célébrités de l’époque comme Louis Jouvet, Anatole France ou Léon Tolstoï notamment.
130 ans après, la scène est toujours ouverte sur la futaie, les comédiens amateurs et professionnels sont toujours bénévoles et le public est toujours au rendez vous. 18 000 spectateurs sont venus à Bussang en 2025 pour assister aux représentations.
Lire aussi : Vosges du Nord : voyage au pays des verriers
Mirecourt, berceau de la lutherie
Depuis plus de trois siècles, la petite cité bucolique de Mirecourt est reconnue pour son savoir-faire dans la facture des instruments à cordes et archets.
Inventé en Italie au début du XVIe siècle, le violon apparait à Mirecourt à la fin de ce même siècle. Les archives indiquent que les premiers facteurs d’instruments à cordes sont arrivés en 1619. La cité a connu son âge d’or au XIXe siècle, rivalisant avec Crémone, en Italie.
Viennent les usines au XXe siècle, époque à laquelle la ville produira jusqu’à 40 000 violons entre les deux conflits mondiaux.
Elle passe à 850 employés en 1925, puis à 200 en 1950. Aujourd’hui, on compte une douzaine de luthiers et archetiers. Ils perpétuent ce savoir-faire et des jeunes gens viennent apprendre leur métier à l’École Nationale de Lutherie, la seule en France.
Le musée vaut le détour. Il raconte et valorise la production traditionnelle et actuelle. Une centaine d’instruments de toutes les époques sont présentés comme partie intégrante du monde de la musique qui réunit les luthiers et les archetiers qui les fabriquent, les musiciens qui les jouent, les compositeurs qui les valorisent, les auditeurs et les critiques qui les écoutent et les jugent.
Depuis sa création en 1973, la collection du Musée de Mirecourt ne cesse de s’enrichir avec de prestigieux ou de plus humbles témoins d’expositions thématiques régulières. Violons, violoncelles, guitares, mandolines…
Et depuis 2005, la salle d’exposition du musée est installée dans une ancienne scierie à bois de lutherie réaménagée. Avant d’être utilisé dans la fabrication des instruments et des accessoires, le bois des futaies vosgiennes était stocké pendant plusieurs années pour sécher à l’abri du soleil.
Lire aussi : Le Grand Est, une région dépaysante, avec l'agence Lisela
Inventé en Italie au début du XVIe siècle, le violon apparait à Mirecourt à la fin de ce même siècle. Les archives indiquent que les premiers facteurs d’instruments à cordes sont arrivés en 1619. La cité a connu son âge d’or au XIXe siècle, rivalisant avec Crémone, en Italie.
Viennent les usines au XXe siècle, époque à laquelle la ville produira jusqu’à 40 000 violons entre les deux conflits mondiaux.
Elle passe à 850 employés en 1925, puis à 200 en 1950. Aujourd’hui, on compte une douzaine de luthiers et archetiers. Ils perpétuent ce savoir-faire et des jeunes gens viennent apprendre leur métier à l’École Nationale de Lutherie, la seule en France.
Le musée vaut le détour. Il raconte et valorise la production traditionnelle et actuelle. Une centaine d’instruments de toutes les époques sont présentés comme partie intégrante du monde de la musique qui réunit les luthiers et les archetiers qui les fabriquent, les musiciens qui les jouent, les compositeurs qui les valorisent, les auditeurs et les critiques qui les écoutent et les jugent.
Depuis sa création en 1973, la collection du Musée de Mirecourt ne cesse de s’enrichir avec de prestigieux ou de plus humbles témoins d’expositions thématiques régulières. Violons, violoncelles, guitares, mandolines…
Et depuis 2005, la salle d’exposition du musée est installée dans une ancienne scierie à bois de lutherie réaménagée. Avant d’être utilisé dans la fabrication des instruments et des accessoires, le bois des futaies vosgiennes était stocké pendant plusieurs années pour sécher à l’abri du soleil.
Lire aussi : Le Grand Est, une région dépaysante, avec l'agence Lisela
Paroles de « La vie en Vosges » enregistrées par Jeane Manson dans son dernier album, en septembre 2025
Quand mon cœur résonne
Comme un écho profond
Et comme les Vosgiens
Je célèbre ma passion
On a dessiné
Le Nouveau Monde, est né
À Saint-Dié, fut baptisé
La France, l’Amérique
Carrefour humaniste
Vittel, Contrexéville
Et les eaux s’illuminent
Les Vosges séduisent
Les passants sourient
On est tellement bien ici
Je vois la vie en Vosges
Parmi les plus hautes
Montagnes
Ces lacs, son massif
Je vois la vie en Vosges
Comme si, comme un
Jour de fête
La vie en Vosges, la vie se vit
Quand le jour se lève
L’air pur me reçoit
La ville s’éveille
Pour fabriquer de l’art
Tant de merveilles
De traditions vosgiennes
Bonbon bleuet, tarte aux
Brimbelles
Quand la forêt vibre
Au chant des oiseaux
Telle une symphonie
Oh mon Dieu que c’est beau
Viens voir ici
Chaque enfant sourit
Pour le bonheur du pays
Je vois la vie en Vosges
Ce soir
Sous les milliers d’étoiles
Qui brillent dans le ciel
Je vois la vie en Vosges
Comme si, comme un
Jour de fête
Et je vois la vie en Vosges
Remiremont, Épinal,
Et Domrémy
Terre idyllique
Je t’invite à la vivre
La vie
Je marche dans la nature
Et je me sens libre,
Les chalets colorés,
Le MUDAC, le Musée de l’Image, la musique,
La neige qui brille, et le miel
De sapins
Je vois la voie en Vosges
Je vois, se dresser l’arc
En ciel
Les Vosges sont si belles
Je vois la vie en Vosges parmi
Les parfums, les arômes,
Oui je vois la vie en Vosges
Où se trouve ma liberté
Oui je vois la vie en Vosges
Comme un écho profond
Et comme les Vosgiens
Je célèbre ma passion
On a dessiné
Le Nouveau Monde, est né
À Saint-Dié, fut baptisé
La France, l’Amérique
Carrefour humaniste
Vittel, Contrexéville
Et les eaux s’illuminent
Les Vosges séduisent
Les passants sourient
On est tellement bien ici
Je vois la vie en Vosges
Parmi les plus hautes
Montagnes
Ces lacs, son massif
Je vois la vie en Vosges
Comme si, comme un
Jour de fête
La vie en Vosges, la vie se vit
Quand le jour se lève
L’air pur me reçoit
La ville s’éveille
Pour fabriquer de l’art
Tant de merveilles
De traditions vosgiennes
Bonbon bleuet, tarte aux
Brimbelles
Quand la forêt vibre
Au chant des oiseaux
Telle une symphonie
Oh mon Dieu que c’est beau
Viens voir ici
Chaque enfant sourit
Pour le bonheur du pays
Je vois la vie en Vosges
Ce soir
Sous les milliers d’étoiles
Qui brillent dans le ciel
Je vois la vie en Vosges
Comme si, comme un
Jour de fête
Et je vois la vie en Vosges
Remiremont, Épinal,
Et Domrémy
Terre idyllique
Je t’invite à la vivre
La vie
Je marche dans la nature
Et je me sens libre,
Les chalets colorés,
Le MUDAC, le Musée de l’Image, la musique,
La neige qui brille, et le miel
De sapins
Je vois la voie en Vosges
Je vois, se dresser l’arc
En ciel
Les Vosges sont si belles
Je vois la vie en Vosges parmi
Les parfums, les arômes,
Oui je vois la vie en Vosges
Où se trouve ma liberté
Oui je vois la vie en Vosges























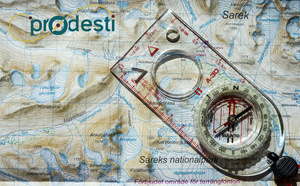










![Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93945726-65568018.jpg?v=1769613161)

















