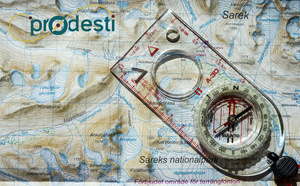Aurélien Bigo a étudié l’évolution des émissions des transports de 1960 à 2023 - Depositphotos @alphaspirit
Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman pose les bases de la construction européenne.
Le jour de la capitulation de l’Allemagne nazie n’est pas encore férié — il le deviendra trois ans plus tard — et pourtant, cette année est marquée par un excellent cru de l’activité touristique.
Dans un pays en reconstruction, les étrangers affluent : ils sont 2,8 millions de touristes, soit un quart de l’ensemble des déplacements (étrangers) en Europe. La France est déjà une locomotive, selon les chiffres du Commissariat au Tourisme.
Soixante-dix ans plus tard, les près de 3 millions de voyageurs d’alors sont devenus plus de 100 millions - un cap symbolique, mais contesté par certains.
Un développement presque exponentiel, qui ne devrait pas s’arrêter là, et qui a permis à notre économie de prospérer, et à des pans entiers de notre territoire de se développer, que ce soit sur le littoral ou en montagne.
Une activité qui entraîne avec elle le secteur des transports.
Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des transports, vient de publier dans La Revue de l’Énergie un article scientifique consacré à l’évolution des émissions du transport de voyageurs en France, de 1960 à nos jours.
Nous revenons sur cette étude pour comprendre les marges de progression de l’industrie touristique.
Tourisme : Le transport international augmente de 4,4 % les émissions nationales
Il représente, en 2023, 37 % des émissions de gaz à effet de serre en France, contre 30 % en 2014. Malgré les innovations technologiques, les moteurs moins polluants et les voitures électriques, sa part n’a cessé de grandir.
D’ailleurs, ces dernières semaines, une conférence de financement a été organisée par Philippe Tabarot, le ministre des Transports.
Cet événement a été l’occasion de faire émerger de nouvelles façons de financer le développement et de répondre aux problématiques d’un secteur confronté non seulement au réchauffement climatique, mais aussi aux besoins de renouvellement des infrastructures, aux contraintes budgétaires d’un gouvernement faisant face à la crise de la dette et aux impératifs de durabilité.
"L'enjeu est d'aboutir à un rapport général qui soit capable de présenter de grands scénarios sur le financement des infrastructures, tout en respectant les deux grandes clés d'entrée que sont le cadre contraint des finances publiques et la stratégie nationale bas carbone.
Le secteur des transports est l'un des secteurs le plus en retard sur ces objectifs de décarbonation, plus que l'énergie et l'industrie," nous confiait un interlocuteur depuis le ministère des Transports, en marge de la conférence.
Et si le transport est à la traîne, la branche du transport de voyageurs n’est pas nécessairement en meilleure situation.
Il faut dire que le tourisme ne peut se développer sans mouvement, que ce soit à l’aide des automobiles, du ferroviaire ou des avions.
Le tourisme a émis, en 2022, 97 millions de tonnes de CO₂, dont 70 % liées au seul transport, d'après les chiffres de l'ADEME.. Un niveau important, qui n’inclut pas les émissions du transport international, notamment l’aérien, ainsi que les achats non produits sur le territoire français.
D’après Aurélien Bigo, les émissions du transport international ajouteraient l’équivalent de 4,4 % des émissions nationales au bilan du secteur.
"Il est ainsi primordial de suivre l’évolution de ces émissions et le respect de la trajectoire fixée dans la Stratégie nationale bas-carbone validée en 2020, d’autant plus que cette stratégie est en cours de révision avec des objectifs renforcés à l’horizon 2030, notamment pour le secteur des transports," recontextualise le chercheur, associé à la Chaire Énergie et Prospérité.
Transport de voyageurs : pic des émissions atteint en 2004
Pour en revenir au tourisme, si le secteur a connu des décennies de prospérité, il a aussi embarqué dans son ascension le secteur des transports.
Sans surprise, entre 1960 et 2023, les émissions de CO₂ du transport de voyageurs en France ont été multipliées par 4,5, tout en sachant que le pic a été atteint en 2004.
Cette hausse des émissions s’explique facilement, puisque sur cette même période, la demande a été multipliée par 5,8, toujours selon l'article.
À noter que si la baisse de la consommation des véhicules est la principale raison de la réduction de la pollution du secteur, le changement de répartition entre les modes de transport a, lui, eu l'effet inverse et quasiment dans les mêmes proportions.
Puisque la part de la voiture et de l'avion a augmenté, au détriment du ferroviaire, alors même que les kilomètres parcourus par les Français ont fortement augmenté au fil du temps.
Depuis les années 1960, les courbes de la demande et des émissions se suivent comme un reflet, avant de s'éloigner au milieu des années 2000.
Nous observons "un léger découplage de l’ordre de -1,5 %/an (les émissions sont moins importantes que la demande, ndlr).
La hausse de la demande est relativement régulière sur l’ensemble de la période, hormis le choc de la crise Covid en 2020, suite à quoi la demande n’a pas retrouvé son niveau de 2019, y compris en 2023," explique l'article.
Comme le rappelle l’ADEME, si ce découplage est salutaire, il n’est pas non plus la panacée.
Le secteur du tourisme, donc du transport de voyageurs, doit agir, et vite. Il doit baisser ses émissions de 35 à 50 % d’ici 2030. Pour y parvenir, les leviers ne sont pas nombreux, mais ils existent malgré tout.
Il est donc nécessaire d’agir sur la provenance des touristes, en privilégiant les marchés émetteurs proches, et sur les modes de transport. Le déploiement de la voiture électrique sera une action salutaire, mais ce ne sera pas la seule piste à actionner pour faire chuter la pollution.
Le chercheur associé de la Chaire Énergie et Prospérité s’est ensuite penché sur la dernière décennie.
Sans surprise, entre 1960 et 2023, les émissions de CO₂ du transport de voyageurs en France ont été multipliées par 4,5, tout en sachant que le pic a été atteint en 2004.
Cette hausse des émissions s’explique facilement, puisque sur cette même période, la demande a été multipliée par 5,8, toujours selon l'article.
À noter que si la baisse de la consommation des véhicules est la principale raison de la réduction de la pollution du secteur, le changement de répartition entre les modes de transport a, lui, eu l'effet inverse et quasiment dans les mêmes proportions.
Puisque la part de la voiture et de l'avion a augmenté, au détriment du ferroviaire, alors même que les kilomètres parcourus par les Français ont fortement augmenté au fil du temps.
Depuis les années 1960, les courbes de la demande et des émissions se suivent comme un reflet, avant de s'éloigner au milieu des années 2000.
Nous observons "un léger découplage de l’ordre de -1,5 %/an (les émissions sont moins importantes que la demande, ndlr).
La hausse de la demande est relativement régulière sur l’ensemble de la période, hormis le choc de la crise Covid en 2020, suite à quoi la demande n’a pas retrouvé son niveau de 2019, y compris en 2023," explique l'article.
Comme le rappelle l’ADEME, si ce découplage est salutaire, il n’est pas non plus la panacée.
Le secteur du tourisme, donc du transport de voyageurs, doit agir, et vite. Il doit baisser ses émissions de 35 à 50 % d’ici 2030. Pour y parvenir, les leviers ne sont pas nombreux, mais ils existent malgré tout.
Il est donc nécessaire d’agir sur la provenance des touristes, en privilégiant les marchés émetteurs proches, et sur les modes de transport. Le déploiement de la voiture électrique sera une action salutaire, mais ce ne sera pas la seule piste à actionner pour faire chuter la pollution.
Le chercheur associé de la Chaire Énergie et Prospérité s’est ensuite penché sur la dernière décennie.
Transport de voyageurs : le Covid est-il un game changer ?
Il a dégagé deux périodes de 4 ans : de 2015 à 2019, puis entre 2019 et 2023. Sur la première période, la demande augmente fortement, entraînant avec elle les émissions (+6,5 MtCO₂), et la seconde est marquée par le Covid et la chute de la demande.
Il note aussi que "la réduction des consommations énergétiques est légèrement plus forte après 2019, ces tendances étant essentiellement dues aux évolutions au sein du transport aérien."
La crise sanitaire a été un révélateur pour beaucoup de Français.
Si les nouvelles habitudes sont remises en question par le retour à la vie normale, le vélo a pris une vraie place dans le quotidien des citadins, et le train est redevenu attractif, allant même jusqu’à prendre des parts de marché à l’aérien du moins sur les lignes domestiques, y compris dans le business travel.
Une montée en puissance freinée par des tarifs pas toujours avantageux pour le ferroviaire, mais aussi par la faible disponibilité de lignes internationales ou transversales.
Comme nous l'expliquait Alexis Chailloux, du Réseau Action Climat ce constat est avant tout "une question de volonté politique."
Dans le même temps, le transport aérien a essayé d’instaurer une bascule, en entrant dans une politique de décarbonation, tout en améliorant le taux de remplissage.
En plus de commandes d’avions plus récents, donc moins polluants, les compagnies se sont retrouvées dans l’obligation d’incorporer du carburant d’aviation durable (SAF), à hauteur de 1 % en 2022, puis 2 % dès janvier 2025.
Cette proportion doit augmenter pour atteindre 20 % en 2035.
Dans le même temps, le secteur n’a pas encore totalement retrouvé son niveau d’activité pré-Covid. Pour le chercheur, la crise sanitaire n’a pas été la révolution rêvée par certains, mais un accélérateur des tendances de consommation et des politiques pratiquées.
Sur la période d’observation du papier, il est noté que les émissions du transport intérieur de voyageurs ont décru de 11,0 %, alors que la Stratégie nationale bas-carbone anticipait une réduction de 14,6 %.
En résumé, ce n’est pas si mal, mais l’industrie doit pouvoir mieux faire.
Il note aussi que "la réduction des consommations énergétiques est légèrement plus forte après 2019, ces tendances étant essentiellement dues aux évolutions au sein du transport aérien."
La crise sanitaire a été un révélateur pour beaucoup de Français.
Si les nouvelles habitudes sont remises en question par le retour à la vie normale, le vélo a pris une vraie place dans le quotidien des citadins, et le train est redevenu attractif, allant même jusqu’à prendre des parts de marché à l’aérien du moins sur les lignes domestiques, y compris dans le business travel.
Une montée en puissance freinée par des tarifs pas toujours avantageux pour le ferroviaire, mais aussi par la faible disponibilité de lignes internationales ou transversales.
Comme nous l'expliquait Alexis Chailloux, du Réseau Action Climat ce constat est avant tout "une question de volonté politique."
Dans le même temps, le transport aérien a essayé d’instaurer une bascule, en entrant dans une politique de décarbonation, tout en améliorant le taux de remplissage.
En plus de commandes d’avions plus récents, donc moins polluants, les compagnies se sont retrouvées dans l’obligation d’incorporer du carburant d’aviation durable (SAF), à hauteur de 1 % en 2022, puis 2 % dès janvier 2025.
Cette proportion doit augmenter pour atteindre 20 % en 2035.
Dans le même temps, le secteur n’a pas encore totalement retrouvé son niveau d’activité pré-Covid. Pour le chercheur, la crise sanitaire n’a pas été la révolution rêvée par certains, mais un accélérateur des tendances de consommation et des politiques pratiquées.
Sur la période d’observation du papier, il est noté que les émissions du transport intérieur de voyageurs ont décru de 11,0 %, alors que la Stratégie nationale bas-carbone anticipait une réduction de 14,6 %.
En résumé, ce n’est pas si mal, mais l’industrie doit pouvoir mieux faire.
Transport de voyageurs : les leviers d'action pour rentrer dans les clous
Autres articles
-
 Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
-
 Espagne : un accident de trains fait 39 morts
Espagne : un accident de trains fait 39 morts
-
 Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
-
 Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance
Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance
-
 Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
Et malheureusement, les indicateurs laissent penser que la trajectoire n’est toujours pas suffisamment engagée pour atteindre les objectifs.
Pire encore, 2024 marque un tournant puisque les émissions de l’ensemble du secteur des transports se sont redressées (+0,15 %).
Concernant les émissions des transports de voyageurs, la dynamique serait relativement similaire. Du moins, si l’on prend en compte les vols internationaux, la hausse serait de +0,8 %.
"L’écart se creuse entre l’objectif climatique et les émissions observées.
Le respect des objectifs climatiques de court terme risque d’être encore fortement conditionné par l’évolution de la demande de transport, qui est fortement dépendante d’effets conjoncturels, que ça soit l’évolution du prix des carburants, ou encore l’évolution du PIB, de l’inflation et du pouvoir d’achat" déplore Aurélien Bigo.
Un constat implacable, alors même que des scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C "n’est plus un objectif atteignable", rendant caduc l’accord de Paris et plongeant l’humanité dans l’incertitude.
Il existe malgré tout des leviers pour permettre à l’industrie touristique de redresser la pente et de faire sa part.
S’il sera compliqué d’agir sur la demande - on imagine difficilement des politiques incitant la population à rester chez elle et restreignant les déplacements -, les pouvoirs publics pourront plutôt avoir une action sur le report modal.
Entre 1960 et 2023, le mode de transport ayant le plus progressé est l’aérien, dont la demande a été multipliée par 56, contre 8 pour les bus et cars, 6,6 pour les transports routiers individuels et 3,1 pour le transport ferroviaire.
L’un des principaux enjeux des prochaines années sera donc de réorienter la demande vers des moyens plus propres, puis de pousser vers des carburants plus durables, qui ne semblent pas être réelle solution selon Oxfam, ou encore l’électrification, à condition que sa production soit décarbonée.
S’il ne faut pas tout attendre de l’État - d’autant plus dans cette période de disette budgétaire -, les politiques publiques doivent donner une direction positive à un secteur qui ne pourra pas faire l’économie d’efforts, pour conserver un climat vivable et des destinations attrayantes.
Pire encore, 2024 marque un tournant puisque les émissions de l’ensemble du secteur des transports se sont redressées (+0,15 %).
Concernant les émissions des transports de voyageurs, la dynamique serait relativement similaire. Du moins, si l’on prend en compte les vols internationaux, la hausse serait de +0,8 %.
"L’écart se creuse entre l’objectif climatique et les émissions observées.
Le respect des objectifs climatiques de court terme risque d’être encore fortement conditionné par l’évolution de la demande de transport, qui est fortement dépendante d’effets conjoncturels, que ça soit l’évolution du prix des carburants, ou encore l’évolution du PIB, de l’inflation et du pouvoir d’achat" déplore Aurélien Bigo.
Un constat implacable, alors même que des scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C "n’est plus un objectif atteignable", rendant caduc l’accord de Paris et plongeant l’humanité dans l’incertitude.
Il existe malgré tout des leviers pour permettre à l’industrie touristique de redresser la pente et de faire sa part.
S’il sera compliqué d’agir sur la demande - on imagine difficilement des politiques incitant la population à rester chez elle et restreignant les déplacements -, les pouvoirs publics pourront plutôt avoir une action sur le report modal.
Entre 1960 et 2023, le mode de transport ayant le plus progressé est l’aérien, dont la demande a été multipliée par 56, contre 8 pour les bus et cars, 6,6 pour les transports routiers individuels et 3,1 pour le transport ferroviaire.
L’un des principaux enjeux des prochaines années sera donc de réorienter la demande vers des moyens plus propres, puis de pousser vers des carburants plus durables, qui ne semblent pas être réelle solution selon Oxfam, ou encore l’électrification, à condition que sa production soit décarbonée.
S’il ne faut pas tout attendre de l’État - d’autant plus dans cette période de disette budgétaire -, les politiques publiques doivent donner une direction positive à un secteur qui ne pourra pas faire l’économie d’efforts, pour conserver un climat vivable et des destinations attrayantes.








 Publié par Romain Pommier
Publié par Romain Pommier 




![Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO] Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93922888-65555839.jpg?v=1769530018)

![Quelles croisières proposer à vos clients en couple ? [ABO] Quelles croisières proposer à vos clients en couple ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93852301-65524510.jpg?v=1769513504)
![CEDIV - Selectour : l’avenir du partenariat en question ? [ABO] CEDIV - Selectour : l’avenir du partenariat en question ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93901404-65543656.jpg?v=1769496563)
![Marchés : l'euro profite du désamour pour le dollar sur fond de crise au Groenland [ABO] Marchés : l'euro profite du désamour pour le dollar sur fond de crise au Groenland [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93899247-65541447.jpg?v=1769420218)
![Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/93852662-65524623.jpg?v=1769430482)

![Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93778464-65484235.jpg?v=1768841214)

![Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO] Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93677814-65431119.jpg?v=1768317073)
![Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93575745-65377296.jpg?v=1767793700)