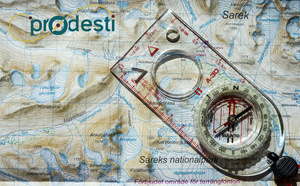Le Réseau Action Climat publie l’étude “Le monde à l’envers” comparant les prix des billets de train et d'avion, en France et Europe - Crédit photo : visuel réalisé à l'aide de l'IA
Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.
Le transport est le premier émetteur de GES (gaz à effet de serre) en France. Il représente environ 30% des émissions du pays.
Lors de la dernière Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), validée en 2020, il devait montrer l’exemple en réduisant drastiquement sa pollution, de l’ordre de -14,6 % (soit 13,5 MtCO2e) entre 2015 et 2023, comme l'explique Aurélien Bigo.
Bien que nous ne soyons pas loin de l’objectif, il n’a pas été atteint. Il reste encore un quart d’effort à fournir pour y parvenir.
"L’effet du report modal a été moins important qu’attendu (-1,2% au lieu de -2,1%), en raison d’un léger retard sur le ferroviaire, d’une baisse des bus et cars, et d’une hausse trop forte de l’aérien," explique le chercheur sur la transition des transports.
Et il est certain que ce report modal, appelé par l’ensemble des militants et acteurs d’un tourisme plus durable, peine à se frayer un chemin dans l’esprit des voyageurs français.
Ce n’est sans doute pas faute de volonté, mais plutôt de moyens. Réseau Action Climat démontre pourquoi l’avion est souvent préféré au train pour les déplacements en France et en Europe.
"Je pense que beaucoup de voyageurs ont ressenti l’impression qu’un trajet depuis la France et vers l’Europe en train coûte assez cher, puis, s’ils regardent le même itinéraire en avion, il est sensiblement moins cher.
Nous avons souhaité objectiver ce sentiment en apportant des chiffres et des solutions pour rééquilibrer ce monde à l’envers.
Dans un monde où nous essayons de promouvoir un mode de vie le moins polluant possible, nous devrions faire en sorte que les billets de train soient moins chers que ceux des compagnies aériennes.
Or, c’est l’inverse qui se produit," introduit Alexis Chailloux, le responsable aérien et ferroviaire au sein de l’association.
France : "le train est moins cher sur les lignes directes"
D’après le dernier rapport de l’ADEME (BEGES), basé sur les données de 2022 - donc biaisées, car les visiteurs étrangers n’étaient pas tous revenus dans notre pays - l’industrie touristique émettait 97 millions de tonnes de CO₂, dont 70% pour le seul transport.
L’aviation représente à elle seule 29% des émissions totales du secteur.
"Nous avons travaillé sur les trajets franco-français et ceux entre la France et l’Europe.
Nous nous sommes basés sur le travail de l’UFC-Que Choisir, qui a comparé les tarifs pratiqués sur les 48 lignes aériennes domestiques les plus fréquentées, en comparant à chaque fois le prix le plus bas sur plusieurs dates pour les deux modes de transport.
Il y a une bonne nouvelle : le train est moins cher lorsqu’il existe une ligne directe. Le train Paris-Marseille est moins cher que l’avion. Par contre, dès qu’il faut une correspondance sur un trajet en train, l’avion est systématiquement moins cher.
Cela pose la question de la connectivité ferroviaire," poursuit le responsable de l'association.
Il ressort des chiffres de l’UFC-Que Choisir que le prix moyen le plus bas sur 25 lignes directes ferroviaires domestiques est de 64 euros, contre 106 euros pour l’aérien (+40%), tandis qu’il devient 10% plus cher pour le train dès qu’une correspondance est nécessaire.
Et cette problématique des correspondances pourrait encore s’accentuer si toutes les régions suivaient l’exemple de la Normandie, devenue autorité organisatrice des liaisons relevant de l’activité des Trains d’Équilibre du Territoire (les Intercités).
Cette régionalisation a entraîné une hausse des prix des billets : +5,16% pour les trajets entre la Normandie et Paris, et parfois bien plus, en raison de la tarification dynamique.
"Cette tarification décourage un mode de transport nettement moins polluant"
Il est donc urgent de développer davantage de lignes transversales, comme entre Bordeaux et Lyon, Marseille et Nantes, ou Lille et Nice, par exemple.
Si le train parvient à être compétitif sur les lignes intérieures françaises, il est systématiquement moins avantageux que l’avion dès qu’il franchit les frontières de l’Hexagone.
"Greenpeace va publier une enquête européenne durant l’été, que nous avons pu exploiter.
Nous avons analysé une vingtaine de lignes au départ de la France vers l’étranger et constatons que le prix moyen en train est systématiquement 2,5 fois supérieur à celui de l’avion.
Ce déséquilibre est particulièrement contre-productif d’un point de vue environnemental, car un trajet Paris - Barcelone émet 70 fois plus de CO₂ en avion qu’en train.
Cette tarification décourage un mode de transport nettement moins polluant et respectueux," déplore Alexis Chailloux.
Ils ont comparé 21 lignes à 9 dates différentes pour obtenir un jeu de données relativement exhaustif. Les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de passagers aériens.
Concrètement, la ligne Paris - Milan affiche un prix moyen de 151 euros en train, contre 48 euros en avion (x3,2), tandis que Paris - Londres revient en moyenne à 120 euros en train, contre 44 euros pour l’aérien (x2,7).
Si le train est perdant dans tous les cas sur le plan tarifaire, il l’est aussi en matière de capacité.
Par exemple, les compagnies aériennes proposent 8 000 sièges quotidiens entre la capitale française et celle de la Catalogne, alors que la SNCF n’assure que deux rames, soit environ 1 000 sièges, selon les données de Réseau Action Climat.
L’aérien a connu une véritable démocratisation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme le démontre le post Linkedin d'Aurélien Bigo, entraînant un décuplement des capacités.
Quand un Français parcourait en moyenne 7,5 km par jour en voiture, 2,3 km en train et 0,2 km en avion en 1960, trente ans plus tard, la voiture atteignait 31,6 km, le train 3,6 km et l’avion 3,1 km par jour et par habitant.
En 2023, la voiture a légèrement reculé (34 km), face à… l’aérien (9,3 km) et au train (5 km).
Si le train parvient à être compétitif sur les lignes intérieures françaises, il est systématiquement moins avantageux que l’avion dès qu’il franchit les frontières de l’Hexagone.
"Greenpeace va publier une enquête européenne durant l’été, que nous avons pu exploiter.
Nous avons analysé une vingtaine de lignes au départ de la France vers l’étranger et constatons que le prix moyen en train est systématiquement 2,5 fois supérieur à celui de l’avion.
Ce déséquilibre est particulièrement contre-productif d’un point de vue environnemental, car un trajet Paris - Barcelone émet 70 fois plus de CO₂ en avion qu’en train.
Cette tarification décourage un mode de transport nettement moins polluant et respectueux," déplore Alexis Chailloux.
Ils ont comparé 21 lignes à 9 dates différentes pour obtenir un jeu de données relativement exhaustif. Les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de passagers aériens.
Concrètement, la ligne Paris - Milan affiche un prix moyen de 151 euros en train, contre 48 euros en avion (x3,2), tandis que Paris - Londres revient en moyenne à 120 euros en train, contre 44 euros pour l’aérien (x2,7).
Si le train est perdant dans tous les cas sur le plan tarifaire, il l’est aussi en matière de capacité.
Par exemple, les compagnies aériennes proposent 8 000 sièges quotidiens entre la capitale française et celle de la Catalogne, alors que la SNCF n’assure que deux rames, soit environ 1 000 sièges, selon les données de Réseau Action Climat.
L’aérien a connu une véritable démocratisation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme le démontre le post Linkedin d'Aurélien Bigo, entraînant un décuplement des capacités.
Quand un Français parcourait en moyenne 7,5 km par jour en voiture, 2,3 km en train et 0,2 km en avion en 1960, trente ans plus tard, la voiture atteignait 31,6 km, le train 3,6 km et l’avion 3,1 km par jour et par habitant.
En 2023, la voiture a légèrement reculé (34 km), face à… l’aérien (9,3 km) et au train (5 km).
"L’exonération fiscale de l’aérien représente un avantage de 27 euros par billet !"
La question capacitaire n’est pas le seul facteur expliquant ce différentiel conséquent.
Pour évaluer les causes de cette différence, l’association a mandaté Carbone 4 afin que le cabinet liste les coûts de transport de l’aérien et du ferroviaire.
"Les deux principales explications qui ressortent sont : l’exonération fiscale de l’aérien - entre l’absence de TVA et de taxe kérosène - cela représente un avantage de 27 euros sur un trajet Paris-Barcelone.
Et la deuxième raison est le poids des péages ferroviaires, donc les redevances pour circuler sur le réseau, qui représentent 50 % des coûts d’un billet.
De plus, les low-cost aériennes sont très présentes sur les lignes européennes, ce qui n’est pas le cas dans le ferroviaire, car Ouigo ne relie pas de grandes villes européennes, alors que leurs tarifs sont 30 % moins chers que ceux des compagnies traditionnelles.
À ce cocktail, vous ajoutez la tarification dynamique qui plombe le train, puisque les capacités ne sont pas les mêmes que celles proposées par les avions," estime le responsable aérien et ferroviaire au sein de l'association.
Le sentiment d’urgence au moment de la réservation est nettement plus élevé pour un voyage terrestre.
Et la concurrence ne pourra pas être une solution, du moins pas sur l’ensemble du réseau, et sans doute pas à long terme, du fait d'une ristourne sur les droits de péage accordée aux nouvelles compagnies qui font face à la SNCF.
"Nous n’avons pas assez de recul sur le sujet. Il y a sans doute un léger gain, mais se pose la question de sa pérennité, tout comme des effets de bord qu’il convient d’observer.
En effet, la SNCF gagne surtout de l’argent sur les dessertes TGV, qui permettent ensuite d’assurer des liaisons déficitaires un peu partout en France.
Donc, cette bataille menée sur les lignes rentables entre Paris, Lyon et Marseille fait que l’opérateur gagne moins d’argent et ne pourra peut-être plus assurer à terme ces petites lignes.
De plus, la concurrence a tendu les relations entre les opérateurs historiques européens," déplore-t-il.
Pour évaluer les causes de cette différence, l’association a mandaté Carbone 4 afin que le cabinet liste les coûts de transport de l’aérien et du ferroviaire.
"Les deux principales explications qui ressortent sont : l’exonération fiscale de l’aérien - entre l’absence de TVA et de taxe kérosène - cela représente un avantage de 27 euros sur un trajet Paris-Barcelone.
Et la deuxième raison est le poids des péages ferroviaires, donc les redevances pour circuler sur le réseau, qui représentent 50 % des coûts d’un billet.
De plus, les low-cost aériennes sont très présentes sur les lignes européennes, ce qui n’est pas le cas dans le ferroviaire, car Ouigo ne relie pas de grandes villes européennes, alors que leurs tarifs sont 30 % moins chers que ceux des compagnies traditionnelles.
À ce cocktail, vous ajoutez la tarification dynamique qui plombe le train, puisque les capacités ne sont pas les mêmes que celles proposées par les avions," estime le responsable aérien et ferroviaire au sein de l'association.
Le sentiment d’urgence au moment de la réservation est nettement plus élevé pour un voyage terrestre.
Et la concurrence ne pourra pas être une solution, du moins pas sur l’ensemble du réseau, et sans doute pas à long terme, du fait d'une ristourne sur les droits de péage accordée aux nouvelles compagnies qui font face à la SNCF.
"Nous n’avons pas assez de recul sur le sujet. Il y a sans doute un léger gain, mais se pose la question de sa pérennité, tout comme des effets de bord qu’il convient d’observer.
En effet, la SNCF gagne surtout de l’argent sur les dessertes TGV, qui permettent ensuite d’assurer des liaisons déficitaires un peu partout en France.
Donc, cette bataille menée sur les lignes rentables entre Paris, Lyon et Marseille fait que l’opérateur gagne moins d’argent et ne pourra peut-être plus assurer à terme ces petites lignes.
De plus, la concurrence a tendu les relations entre les opérateurs historiques européens," déplore-t-il.
Train plus cher que l’avion : "une question de volonté politique"
Dans le même temps, la SNCF met du matériel qui serait utile sur le réseau national pour accroitre l'offre en Espagne et bientôt en Italie.
Comme le tourisme est une économie de l’offre, le transport en est tout autant.
"Vous le voyez avec les compagnies low-cost qui desservent les grandes villes touristiques en Europe : plus il y a d’offres, plus les prix sont faibles et plus la demande est soutenue. C’est aussi le cas avec le train.
L’enjeu capacitaire est primordial. D’ailleurs, depuis la crise sanitaire, où l’offre a augmenté, le ferroviaire grignote des parts de marché.
Nous proposons donc la fin des exonérations fiscales aériennes et le rétablissement d’un taux de TVA normal sur les vols internes, la baisse des péages ferroviaires sur les liaisons transversales et internationales.
Notre dernière proposition, reprenant celle lancée durant le Front Populaire, est de proposer un aller-retour chaque année à tous les Français pour 30 euros, pour convertir ceux qui ne prennent pas le train," propose Alexis Chailloux.
Le gouvernement a bien tenté quelque chose avec le pass rail, mais qui a été plutôt un flop.
Pour le responsable du Réseau Action Climat, il n’a pas été une mauvaise initiative.
Sauf qu'elle a sans doute été lancée trop tardivement et, en évinçant les TGV, elle limite énormément l’offre, ce qui réduit l’intérêt de l’initiative. De plus, elle était surtout avantageuse pour ceux qui voyageaient beaucoup en train durant l’été.
"Pour résumer, le rapport démontre que c’est surtout une question de volonté politique.
Que le train soit plus cher que l’avion, ce n’est pas une fatalité. Il suffit de prendre les mesures appropriées et de vouloir changer les choses," conclut-il.
Comme le tourisme est une économie de l’offre, le transport en est tout autant.
"Vous le voyez avec les compagnies low-cost qui desservent les grandes villes touristiques en Europe : plus il y a d’offres, plus les prix sont faibles et plus la demande est soutenue. C’est aussi le cas avec le train.
L’enjeu capacitaire est primordial. D’ailleurs, depuis la crise sanitaire, où l’offre a augmenté, le ferroviaire grignote des parts de marché.
Nous proposons donc la fin des exonérations fiscales aériennes et le rétablissement d’un taux de TVA normal sur les vols internes, la baisse des péages ferroviaires sur les liaisons transversales et internationales.
Notre dernière proposition, reprenant celle lancée durant le Front Populaire, est de proposer un aller-retour chaque année à tous les Français pour 30 euros, pour convertir ceux qui ne prennent pas le train," propose Alexis Chailloux.
Le gouvernement a bien tenté quelque chose avec le pass rail, mais qui a été plutôt un flop.
Pour le responsable du Réseau Action Climat, il n’a pas été une mauvaise initiative.
Sauf qu'elle a sans doute été lancée trop tardivement et, en évinçant les TGV, elle limite énormément l’offre, ce qui réduit l’intérêt de l’initiative. De plus, elle était surtout avantageuse pour ceux qui voyageaient beaucoup en train durant l’été.
"Pour résumer, le rapport démontre que c’est surtout une question de volonté politique.
Que le train soit plus cher que l’avion, ce n’est pas une fatalité. Il suffit de prendre les mesures appropriées et de vouloir changer les choses," conclut-il.
Les Français privilégient de plus en plus le train
Autres articles
-
 Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
-
 Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO]
Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO]
-
 Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology
Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology
-
 Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
-
 Espagne : un accident de trains fait 39 morts
Espagne : un accident de trains fait 39 morts
D'après le dernier rapport multimodal de l’Autorité de régulation des transports (ART), les Français privilégient de plus en plus le train aux déplacements par autoroute pour leurs trajets longue distance.]b
Ainsi, depuis 2019, la fréquentation du ferroviaire a augmenté de +1,2 point de pourcentage (jusqu’en 2023), tandis que celle des véhicules particuliers (-0,5 point) et de l’aérien (-0,2 point) est en recul.
Ainsi, depuis 2019, la fréquentation du ferroviaire a augmenté de +1,2 point de pourcentage (jusqu’en 2023), tandis que celle des véhicules particuliers (-0,5 point) et de l’aérien (-0,2 point) est en recul.








 Publié par Romain Pommier
Publié par Romain Pommier 




![Tourisme d'aventure, Bahreïn, Hongrie, Suède... quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO] Tourisme d'aventure, Bahreïn, Hongrie, Suède... quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/94655791-66138741.jpg?v=1771493447)

![À l'aube de ses 65 ans, Voyages Eurafrique accélère sa diversification [ABO] À l'aube de ses 65 ans, Voyages Eurafrique accélère sa diversification [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/94663785-66145811.jpg?v=1771514018)
![Passager bloqué à New York : mauvaise météo puis problème technique, quid de l'indemnisation ? [ABO] Passager bloqué à New York : mauvaise météo puis problème technique, quid de l'indemnisation ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/94502002-65923816.jpg?v=1771233574)
![Audit de l'État sur les déplacements professionnels : "la démarche de contrôler et d'optimiser est très saine" [ABO] Audit de l'État sur les déplacements professionnels : "la démarche de contrôler et d'optimiser est très saine" [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/94569890-66013051.jpg?v=1771435876)
![Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO] Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/94556459-65997162.jpg?v=1771331363)

![Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/94255971-65749856.jpg?v=1770739085)
![Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/94117568-65653149.jpg?v=1770298665)
![Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/imagette_16_9/93945726-65568018.jpg?v=1769613161)