
Francis Massé : « L'UTA permet de développer des parcours, non pas pour changer des organisations, mais bien pour faire évoluer les femmes et les hommes en termes de mentalité et d’intelligence collective » - Photo : F. Massé
Le saviez-vous ? Parmi les universités et écoles qui proposent des formations spécialisées dans la mobilité et les transports, on trouve une « université » du transport aérien en France, UTA, qui s’apprête à fêter ses dix ans et sa dixième promotion en 2026.
L’UTA n’est pas, à proprement parler, une « université » au sens académique du terme, mais plutôt « un programme de formation très exigeant, stratégique et de réflexion de haut niveau, conçu pour acquérir une connaissance à 360 degrés de l’écosystème et bien comprendre la filière », nous précise Francis Massé, le directeur pédagogique à l’origine de ce projet et avec qui nous nous sommes entretenus.
L’UTA n’est pas, à proprement parler, une « université » au sens académique du terme, mais plutôt « un programme de formation très exigeant, stratégique et de réflexion de haut niveau, conçu pour acquérir une connaissance à 360 degrés de l’écosystème et bien comprendre la filière », nous précise Francis Massé, le directeur pédagogique à l’origine de ce projet et avec qui nous nous sommes entretenus.
L'UTA, une formation pour les cadres de l’aérien
Ayant commencé sa carrière dans le secteur maritime, passé par l’inspection des finances, à RFI et au ministère de l’écologie, Francis Massé aura fait 50% de sa carrière à la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) en tant que DRH, puis secrétaire général jusqu’en 2015.
C’est à la fin de son mandat qu’il a proposé à Patrick Gandil, à l’époque directeur général de la DGAC, l’idée d’UTA. Ce même Patrick Gandil a pris la décision du lancement de ce projet avec des personnalités comme Marc Houalla et Olivier Chansou, l’ancien et l’actuel directeur de l’ENAC.
Ce nouveau concept de formation au niveau de la filière professionnelle - et non plus des seules branches professionnelles - pour relier les métiers et les différentes professions de l’aérien a donc été expérimenté dans le cadre d’une première promotion en 2017.
« Je sentais qu’il fallait développer des parcours, non pas pour changer des organisations, mais bien pour faire évoluer les femmes et les hommes en termes de mentalité et d’intelligence collective », explique Francis Massé, en prenant comme référence la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
« Faire que dans le secteur aérien, tous les chefs, tous les chantiers, toutes les professions travaillent dans les délais, avec rentabilité, mais avec cette intelligence collective qui est de penser la même chose ensemble, d'agir en même temps ensemble, de façon pertinente et cohérente, ceci au sein de l’écosystème tout entier dans un partenariat public/privé assumé ».
L’aventure n’aurait donc pas pu commencer sans l’aide, le parrainage et la validation des responsables de la DGAC et de l’École Nationale de l’Aviation civile (ENAC) qui ont lancé cette formation, et à qui Francis Massé tient à rendre hommage.
Mais, à qui s’adresse cette formation et comment se déroule-t-elle ?
Elle compte en tout 6 modules à l’attention des cadres dirigeants et experts du secteur aérien en activité. Des professionnels du top et du middle management qui possèdent un haut potentiel.
La feuille de route pédagogique a été pensée pour eux et se veut à la fois prospective et opérationnelle, car elle pourra « booster » leur carrière.
C’est à la fin de son mandat qu’il a proposé à Patrick Gandil, à l’époque directeur général de la DGAC, l’idée d’UTA. Ce même Patrick Gandil a pris la décision du lancement de ce projet avec des personnalités comme Marc Houalla et Olivier Chansou, l’ancien et l’actuel directeur de l’ENAC.
Ce nouveau concept de formation au niveau de la filière professionnelle - et non plus des seules branches professionnelles - pour relier les métiers et les différentes professions de l’aérien a donc été expérimenté dans le cadre d’une première promotion en 2017.
« Je sentais qu’il fallait développer des parcours, non pas pour changer des organisations, mais bien pour faire évoluer les femmes et les hommes en termes de mentalité et d’intelligence collective », explique Francis Massé, en prenant comme référence la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
« Faire que dans le secteur aérien, tous les chefs, tous les chantiers, toutes les professions travaillent dans les délais, avec rentabilité, mais avec cette intelligence collective qui est de penser la même chose ensemble, d'agir en même temps ensemble, de façon pertinente et cohérente, ceci au sein de l’écosystème tout entier dans un partenariat public/privé assumé ».
L’aventure n’aurait donc pas pu commencer sans l’aide, le parrainage et la validation des responsables de la DGAC et de l’École Nationale de l’Aviation civile (ENAC) qui ont lancé cette formation, et à qui Francis Massé tient à rendre hommage.
Mais, à qui s’adresse cette formation et comment se déroule-t-elle ?
Elle compte en tout 6 modules à l’attention des cadres dirigeants et experts du secteur aérien en activité. Des professionnels du top et du middle management qui possèdent un haut potentiel.
La feuille de route pédagogique a été pensée pour eux et se veut à la fois prospective et opérationnelle, car elle pourra « booster » leur carrière.
Casser les silos
Ceux qui vont suivre ces modules - les auditeurs - sont envoyés par les DRH ou CEO de leur entreprise ou administration - des acteurs majeurs du transport aérien comme Airbus, Thales et Safran, des aéroports comme ADP, Nice Côte d’Azur et d’autres, des compagnies aériennes, ou encore la DGAC dans ses différentes directions. Il y a aussi désormais des entreprises et organisations en Europe comme Eurocontrol, PANSA, Diehl, DFS, SAFRAN SEAT, etc.
« Il y a 6 modules de 4 jours et demi du printemps à l’hiver, soit exactement 27 jours. Cela représente un temps assez long pour que les professionnels puissent échanger et se comprendre. C'est aussi du temps gagné pour l’avenir », explique Francis Massé.
Et de poursuivre : « Il s’agit de les ouvrir sur l’intégralité de l’écosystème de l’aérien, pour une meilleure compréhension de la filière par les aéroports, les compagnies aériennes, l’ATM (Air Traffic Management, ndlr), les constructeurs, les motoristes, l’assistance en escale, les régulateurs et administrations.
En effet, chaque auditeur arrive avec la culture de sa partie prenante et la culture de l'avionneur n'est pas celle du motoriste, de l'aéroport, ni même de la compagnie aérienne ».
Le vivre ensemble pendant la période de formation va permettre en quelque sorte de casser les silos, de comprendre et d'apprendre les métiers, les missions et les raisons d’être des autres participants.
L’enjeu est bien de dépasser les logiques sectorielles pour penser le transport aérien comme un système global, créer des ponts entre les sphères publiques et privées, anticiper aussi les ruptures technologiques et géopolitiques que vit le secteur.
« Je parlais avec un ancien directeur de la stratégie d'Airbus qui me disait que, de plus en plus, il devait comprendre ce qu'un aéroport attendait d'un avion pour le concevoir, » illustre Francis Massé.
La formation se dispense sous forme de séminaires thématiques, de conférences prospectives sur les mutations du secteur (transition énergétique, digitalisation, souveraineté, etc.), d'ateliers collaboratifs entre décideurs publics et privés et toujours d'une analyse critique des politiques aériennes, des modèles économiques et des innovations.
Par conséquent, les formats pédagogiques variés et innovants permettent une participation et des interactions humaines fréquentes pour enrichir les échanges professionnels.
Les intervenants auprès des auditeurs sont tous des experts et acteurs du secteur reconnus, des ingénieurs, des cadres ou des gestionnaires à fort potentiel, qui maîtrisent parfaitement l'anglais et le français et sont ouverts aux enjeux techniques, managériaux et stratégiques.
« Il y a 6 modules de 4 jours et demi du printemps à l’hiver, soit exactement 27 jours. Cela représente un temps assez long pour que les professionnels puissent échanger et se comprendre. C'est aussi du temps gagné pour l’avenir », explique Francis Massé.
Et de poursuivre : « Il s’agit de les ouvrir sur l’intégralité de l’écosystème de l’aérien, pour une meilleure compréhension de la filière par les aéroports, les compagnies aériennes, l’ATM (Air Traffic Management, ndlr), les constructeurs, les motoristes, l’assistance en escale, les régulateurs et administrations.
En effet, chaque auditeur arrive avec la culture de sa partie prenante et la culture de l'avionneur n'est pas celle du motoriste, de l'aéroport, ni même de la compagnie aérienne ».
Le vivre ensemble pendant la période de formation va permettre en quelque sorte de casser les silos, de comprendre et d'apprendre les métiers, les missions et les raisons d’être des autres participants.
L’enjeu est bien de dépasser les logiques sectorielles pour penser le transport aérien comme un système global, créer des ponts entre les sphères publiques et privées, anticiper aussi les ruptures technologiques et géopolitiques que vit le secteur.
« Je parlais avec un ancien directeur de la stratégie d'Airbus qui me disait que, de plus en plus, il devait comprendre ce qu'un aéroport attendait d'un avion pour le concevoir, » illustre Francis Massé.
La formation se dispense sous forme de séminaires thématiques, de conférences prospectives sur les mutations du secteur (transition énergétique, digitalisation, souveraineté, etc.), d'ateliers collaboratifs entre décideurs publics et privés et toujours d'une analyse critique des politiques aériennes, des modèles économiques et des innovations.
Par conséquent, les formats pédagogiques variés et innovants permettent une participation et des interactions humaines fréquentes pour enrichir les échanges professionnels.
Les intervenants auprès des auditeurs sont tous des experts et acteurs du secteur reconnus, des ingénieurs, des cadres ou des gestionnaires à fort potentiel, qui maîtrisent parfaitement l'anglais et le français et sont ouverts aux enjeux techniques, managériaux et stratégiques.
L’Europe en fil rouge
Depuis le début de cette aventure pédagogique, le fil rouge a toujours été européen, non seulement en ce qui concerne les experts intervenants, mais aussi quant aux différents lieux où se tiennent les modules.
Dès le début, les auditeurs se sont retrouvés dans différents pays européens.
En cette fin de promotion 2025, les participants sont donc à Varsovie pour étudier « l’anticipation du risque », tandis que le dernier module se tiendra à Bruxelles avec pour thème « l’Europe et l’international ».
Et c’est d’ailleurs l’objectif primordial de l’ENAC, d’« européaniser » l'UTA. Ainsi, la grande école du transport aérien de Toulouse s’est associée avec des universités et réseaux européens tels que l’Université Lazarski, l’Universidad Politecnica de Madrid, l’University of the Aegean, le German Aviation Researsh Society.
« Nous faisons venir des intervenants européens et les formations se font dorénavant en anglais. Depuis 2024, nous pouvons dire que nous avons eu une véritable promotion européenne avec deux auditeurs allemands, un espagnol, un roumain, deux polonais et un britannique » se félicite Francis Massé.
Dès le début, les auditeurs se sont retrouvés dans différents pays européens.
En cette fin de promotion 2025, les participants sont donc à Varsovie pour étudier « l’anticipation du risque », tandis que le dernier module se tiendra à Bruxelles avec pour thème « l’Europe et l’international ».
Et c’est d’ailleurs l’objectif primordial de l’ENAC, d’« européaniser » l'UTA. Ainsi, la grande école du transport aérien de Toulouse s’est associée avec des universités et réseaux européens tels que l’Université Lazarski, l’Universidad Politecnica de Madrid, l’University of the Aegean, le German Aviation Researsh Society.
« Nous faisons venir des intervenants européens et les formations se font dorénavant en anglais. Depuis 2024, nous pouvons dire que nous avons eu une véritable promotion européenne avec deux auditeurs allemands, un espagnol, un roumain, deux polonais et un britannique » se félicite Francis Massé.
Un investissement pour les entreprises
Autres articles
-
 L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération
L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération
-
 183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France
183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France
-
 Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?
Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?
-
 DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
-
 Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?
Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?
Cette formation, qui s’adresse donc aux cadres des entreprises de l’aérien, nécessite des moyens destinés au fonctionnement de la formation et à sa logistique très importante.
Elle a donc un coût fixé à 17 000 euros et qui sera réglé par l’entreprise qui décide de faire suivre ce cursus à son ou ses cadres.
Ce coût est, selon Francis Massé, un véritable investissement en faveur du développement futur des entreprises et de l’ensemble de la filière, pour sa performance globale et son efficience.
Un investissement stratégique, directement aligné sur leurs priorités de :
• sécuriser la transformation industrielle vers la durabilité et la souveraineté énergétique ;
• doter les cadres de réflexes d’anticipation et de coordination face à des crises complexes ;
• renforcer la visibilité et l’influence tangible des organisations au sein de la communauté européenne du transport aérien ;
• former une nouvelle génération de dirigeants capables de lier performance, conformité et innovation responsable.
La 10e promotion de l’UTA donne cette année rendez-vous aux auditeurs partout en Europe, et même jusqu’au Canada. Elle prendra son envol en mars 2026 et les inscriptions sont ouvertes : uta-enrolment@enac.fr
Lire aussi :
- Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat
- Aéronautique : un double-diplôme inédit entre Sciences Po Toulouse et l’ENAC
Elle a donc un coût fixé à 17 000 euros et qui sera réglé par l’entreprise qui décide de faire suivre ce cursus à son ou ses cadres.
Ce coût est, selon Francis Massé, un véritable investissement en faveur du développement futur des entreprises et de l’ensemble de la filière, pour sa performance globale et son efficience.
Un investissement stratégique, directement aligné sur leurs priorités de :
• sécuriser la transformation industrielle vers la durabilité et la souveraineté énergétique ;
• doter les cadres de réflexes d’anticipation et de coordination face à des crises complexes ;
• renforcer la visibilité et l’influence tangible des organisations au sein de la communauté européenne du transport aérien ;
• former une nouvelle génération de dirigeants capables de lier performance, conformité et innovation responsable.
La 10e promotion de l’UTA donne cette année rendez-vous aux auditeurs partout en Europe, et même jusqu’au Canada. Elle prendra son envol en mars 2026 et les inscriptions sont ouvertes : uta-enrolment@enac.fr
Lire aussi :
- Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat
- Aéronautique : un double-diplôme inédit entre Sciences Po Toulouse et l’ENAC
 Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com Voir tous les articles de Christophe Hardin






















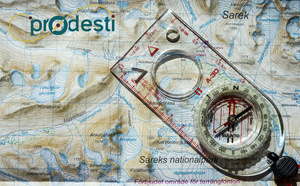











![Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/94117568-65653149.jpg?v=1770298665)















